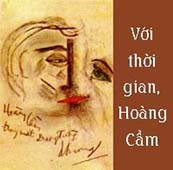Vaya con Díos, Maestro.
Gabriel Gárcia Márquez (1927-2014)
Vaya con Díos, Maestro.
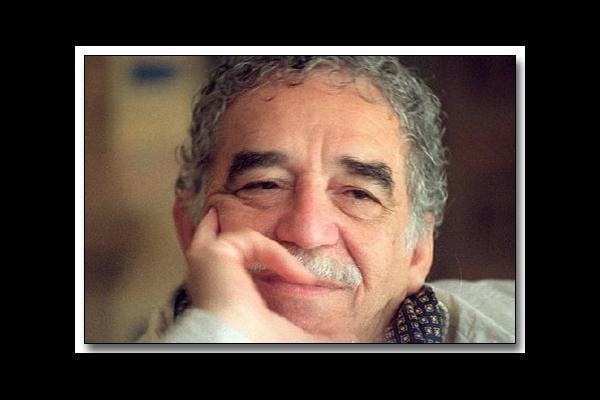
À mon réveil ce matin, je reçois une note courte, presque un ordre amical de Giao, disant textuellement : “ Attends avec impatience ton texte, ne serait-ce que quelques lignes, sur Gabo ”. Il est drôle, Giao, de penser que tout le monde possède son agilité d'esprit et son talent à raconter le vécu. Tous les journaux du continent américain sont remplis de témoignages, d'analyses de ceux qui l'ont connu de près, qui ont travaillé avec lui, qui ont étudié son oeuvre. Qu' ajouter de nouveau ?
Cent ans de Solitude, je l'ai lu lors d'un voyage au Japon en 1977. J'avais, j'ai toujours une angoisse terrible quand je dois prendre l'avion. Surtout celui qui passe par le Pôle Nord. Dans ma tête, ce sont les images laissées par Jack London, ce récit que Lénine faisait lire à sa femme sur son lit de mort et qui raconte l'histoire d'un naufragé perdu dans le grand Nord. Il était suivi par un loup, aussi affamé et affaibli que lui. L'animal attendait le bon moment pour le dévorer. Au moment où notre homme s'effondre de fatigue, le loup se jette sur lui, mais dans un dernier sursaut, l'homme mord le loup et boit son sang, ce qui lui donne suffisamment de force pour ramper jusqu'au poste de secours.
Une amie espagnole à qui je confie mes angoisses m'amène dans une librairie sur le boulevard Saint Germain et m'offre ce livre majeur du Gabo, publié dix ans plus tôt. “ Lis le, la magie ne fera oublier la peur ”. Elle avait raison.
Plus de vingt ans après, je rencontre l'auteur en personne. J'étais membre d'une délégation des Nations Unies chargée de représenter le Secrétaire Général aux cérémonies d'investiture du nouveau Président du Mexique. Le chef de la délégation n'avait en fait qu'une seule envie : faire la connaissance de celui qui symbolise la richesse culturelle du continent américain tout entier. Nous sommes donc allés lui rendre visite chez lui. Rien de bien particulier à rapporter d'une discussion qui a tout de suite prit le ton d'échanges sur tout et sur rien. Ce qui me frappe le plus, c'est la simplicité du personnage et sa capacité de nous mettre immédiatement à l'aise. Me voyant examiner un portrait de lui accroché dans son salon, il me dit en riant : “ Je ne connais pas l'auteur. Quand je suis rentré de mon traitement, j'ai trouvé ce portrait devant ma porte, portrait non signé ”. Un admirateur parmi des millions d'autres. Un autre tableau au dessus de la cheminée a un beau trou au milieu. On lui demande l'origine. Et lui de rire aux éclats avant de raconter l'histoire : la femme d'un de ses amis est férocement jalouse. Un jour, pensant que son mari lui est de nouveau infidèle, elle prend un pistolet et lui tire dessus. Heureusement la balle a frappé ce tableau. Le couple s'est réconcilié et lui a offert cette cible involontaire.

Le chef de notre délégation s'est excusé du mouvement des véhicules devant sa maison. Il le rassure en disant que lors des visites de Fidel Castro, la rue entière est bloquée par les services de sécurité. Puis, montrant le fauteuil dans lequel son invité est assis, il lui dit : “ C'est ici la place de Fidel. Si le fauteuil pouvait parler, il me permettra d'écrire le troisième volume de mes mémoires. D'ailleurs Fidel en a une peur bleue de ce que le fauteuil peut raconter ”.
En prenant congé, je l'ai salué en disant “ Vaya con Díos ”. Avec
un grand sourire il me demande en français, langue qu'il parle
admirablement : “ Où avez vous appris l'espagnol ? ”. Et moi de lui
raconter que lors de mes premiers séjours au Mexique, la bonne des amis
chez qui je logeais s'est donnée comme tâche de m'apprendre à parler la
langue du pays. Gabo hoche la tête, “ au moins, c'est une façon de
parler originale. ”
Dans les années qui ont suivi la publication du tome 1 de ses mémoires, je n'avais plus de soucis à me faire pour trouver des cadeaux aux amis proches. J'allais acheter quelques exemplaires et les lui portais pour demander une dédicace. Si c'est pour une femme, il dessine d'abord une fleur avant d'écrire quelques mots. Mais il signait invariablement, “ un ami ”. Comme si pour lui, le vagabond du continent et l'interlocuteur des plus grands de ce monde, la valeur la plus importante c'est d'abord l'amitié. (Un détail entre mille autres : Gabo interdisait que ses livres soient publiés dans des éditions luxueuses. Il faut, disait-il, qu'ils soient à la portée du plus grand nombre. Il a fallu attendre 2007 pour que Cent ans de Solitude sorte en édition reliée.)
Je ne suis pas sûr que l'on verra un jour un troisième tome de ses mémoires. Fidel peut dormir en paix. Mais je pense qu'il y a quelque chose de magique dans le fait que le personnage principal de son fameux roman, le colonel Buendía, soit mort, comme lui, un jeudi saint. Et je ne peux m'empêcher de penser à cette déclaration du colonel : “ On ne meurt pas quand on doit. On meurt quand on peut ”, et de rapprocher cette phrase de celle d'un ami très proche, décédé il y a un mois, célèbre pour avoir déclaré au président Mitterrand qui lui reprochait de faire des siestes à l'Elysée où il venait déjà fort tard.. “ Monsieur le Président, quand on peut, on doit ”. Toute une philosophie humaniste dans ces simples mots. Au fond, les hommes de bien sont toujours proches les uns des autres, surtout dans leur mots d'esprit. À mon immense regret, je n'ai pu les faire se rencontrer.
Vaya con
Díos, Maestro.
Mexico, 18.4.2014
Nguyễn Hữu Động
Các thao tác trên Tài liệu