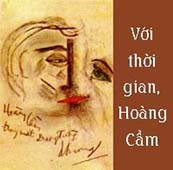Crise européenne
Crise européenne
DE
2008 A 2011 :
FINANCE ET LIBERALISME
Nguyễn Quang
VERSION VIETNAMIENNE :
Từ 2008
đến 2011 : Tài chính và chủ nghĩa "tự do"
Mais qu'arrive-t-il au capitalisme ? L'un après l'autre, il avait enterré tous ses ennemis. Sa résilience, son adaptativité, ses métamorphoses pour survivre à tous les accidents, toutes les catastrophes, toutes les guerres même, avaient fini par faire oublier la prophétie centenaire de Marx -- que le système périrait de ses propres contradictions. Or voici que depuis le milieu des années 80, dans une sorte de caricature de la "théorie" des cycles, les bulles gonflent et les crises éclatent à un rythme accéléré : krach boursier à Wall Street en 1987, au Mexique en 94, en Asie en 97, en Russie en 98, faillite du hedge fund LTCM en 98, du courtier en énergie Enron en 98, krach des valeurs technologiques (bulle Internet) en 2000-2001, faillite de l'Argentine en 2001... Et bien entendu, à l'échelle planétaire, la gigacrise des subprimes de 2008 1. De celle-là, on nous avait vendu l'idée qu'elle était derrière nous, que les experts se souciaient seulement de savoir si la sortie se ferait "en U" ou "en V". Eh bien, non, ce serait plutôt "en W", parce que depuis cet été, la crise des dettes souveraines a pris le relais, qui en vient à menacer les fondements mêmes de l’Union Européenne et de ses Etats constituants.
« Le côté obscur de la Force »
Puisqu'il ne faut plus compter sur les spin doctors des gouvernements ou les ventriloques des médias pour nous refiler autre chose que de la "com", nous convions le lecteur à essayer de voir par lui-même les tenants et aboutissants de cette n-ième crise du capitalisme. D'après Wikipédia, une dette souveraine est une dette émise ou garantie par un émetteur souverain, qui est généralement un Etat ou parfois une banque centrale. Elle peut être constituée de crédits bancaires, de prêts d'autres Etats ou institutions officielles, ou le plus souvent de titres d'emprunts émis par le Trésor public du pays concerné et négociables sur le marché international des obligations (tout le monde connaît par exemple les bons du Trésor américain). Le taux qui s'attache à une obligation d'Etat se détermine par une adjudication auprès des candidats acheteurs. Quand la dette publique d'un pays se détériore, les taux évidemment s'élèvent, reflétant une aggravation du "risque de crédit". Mais quand un Etat débiteur a accumulé trop de déficits budgétaires, ses créanciers peuvent refuser de s'engager davantage, à court terme comme à long terme, d'où une crise de liquidité qui peut s'aggraver en crise de solvabilité. On se souvient que l'offensive des marchés financiers contre les dettes souveraines européennes a commencé au printemps 2010 par des attaques contre la dette grecque. Le cheval de Troie, si l'on peut dire, était bien choisi, à cause du surendettement du pays (120% du PIB à l’époque), mais aussi à cause de ses pratiques irresponsables, comme de maquiller ses comptes ou de lever des fonds hors bilan pour satisfaire aux critères d'entrée dans la zone euro. Malgré plusieurs sommets de l'Eurogroupe et du G20, et des plans de sauvetage présentés à chaque fois comme décisifs (mai 2010, puis mai 2011, juillet 2011, octobre 2011), la situation n'a fait qu'empirer, la spéculation a redoublé, s'étendant à l'Italie (quatrième économie européenne) et menaçant même la France (seconde économie européenne), au point de laisser planer le danger d'un éclatement de la zone euro. Le simple bon sens commande de poser la question : comment est-ce possible ? Comment le mini-problème grec (2% du PIB européen, 4% de la dette européenne) a-t-il pu dégénérer en un problème existentiel pour une Union Européenne qui est tout bonnement la première zone commerciale et économique du monde (PIB de 16 000 milliards E en 2010), devant les USA (14 600 milliards) et la Chine (5 700 milliards) ? Gouvernements et médias agitent régulièrement l’épouvantail d’une crise systémique suivie d'un effet de dominos débouchant sur un « Eurogeddon ».
Les commentateurs officiels sont plutôt avares de développements sur le risque systémique, pour des raisons qui apparaîtront bientôt. Selon Wikipédia, le mot désigne, en finance, la probabilité d'occurrence d'un dysfonctionnement paralysant l'ensemble d'un secteur dans une vaste zone (qui peut être la planète entière!) par le biais d'engagements croisés des acteurs économiques en cause, première étape avant des faillites en chaîne qui conduiraient à terme à un effondrement total du système. Par opposition au risque non systémique, qui apparaît face à un événement extérieur, même majeur (tel qu'une guerre), le systémique exprime un changement d'échelle, une prise en considération globale des mécanismes du phénomène et de son environnement. Personne n'a pu oublier les deux crises systémiques de 1929 et de 2008. Comme par hasard, c'est encore le secteur bancaire qui se retrouve aujourd'hui menacé par son exposition à la dette grecque, et plus généralement aux dettes souveraines de ces Etats que les anglo-saxons qualifient aimablement de "Club Med" (Portugal, Italie, Grèce, Espagne), ou moins aimablement de PIGS (cochons en anglais). Quelle est la gravité de cette menace ? Il est difficile de s'y retrouver dans une jungle de chiffres que les acronymes et les règles comptables (exposition nette, exposition brute...) compliquent à loisir, mais l'on peut se faire une idée en regardant par exemple l'exposition des grandes banques françaises (surtout BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole), que la Banque des Règlements Internationaux (la Banque Centrale des banques) évaluait fin 2010 à près de 400 milliards $. Dans un "top ten" des banques les plus exposées établi par l'EBA (l'Autorité bancaire européenne), la BNP était même championne du monde ! Bref, il apparaît en filigrane que les établissements financiers dans leur ensemble se sont gavés de dettes souveraines comme naguère ils s'étaient gorgés de produits subprimes. Un des motifs d'étonnement du "bon peuple", c'est la rapidité avec laquelle les banques se sont "refaites", comme on dit au casino, après avoir frôlé la faillite en 2008. A peine un an après, elles remboursaient par anticipation les aides publiques, renouaient avec les profits, distribuaient bonus et stock options comme aux plus beaux jours. On n'aura pas la naïveté de croire que ce rétablissement miraculeux ne devait rien à une quelconque spéculation (par exemple sur la dette grecque) avec les crédits si généreusement accordés par les Etats et la BCE à des taux préférentiels... La spéculation se retourne contre les spéculateurs aujourd'hui que la faillite menace les Etats impécunieux. Le danger pour les banques, plus encore que le montant absolu de leur exposition, c'est son taux par rapport à leurs fonds propres : 60% pour la BNP, 150% pour la banque franco-belge Dexia (qui a trépassé depuis). En principe, suivant les bonnes règles prudentielles, les banques détiennent suffisamment de capital pour absorber le risque de crédit, le risque de marché et les risques opérationnels. Les 9/10 d'entre elles ont d'ailleurs passé avec succès les récents "stress tests" basés sur des scénarios de récession sur deux ans en Europe. Sauf que ces tests n'incluaient pas la défaillance grecque -- pas plus que les tests américains de 2007 ne prévoyaient l'effondrement des subprimes. A propos des subprimes, on se souvient d'avoir posé ici même la question du risque systémique : comment une crise immobilière américaine, représentant "seulement" 5% du PIB combiné des USA et de l'UE, a-t-elle pu contaminer la planète financière entière, détruire plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars de richesses et menacer l'économie mondiale (1) ? La réponse, c'est que l'échelle du risque change drastiquement quand intervient la "finance de l'ombre".
La finance de l'ombre, ou shadow banking, ce serait, pour un fan de Star Wars, quelque chose comme "le côté obscur de la Force". C'est un terme maintenant usité désignant un ensemble d'activités financières qui, parce qu'elles ne reçoivent pas de dépôts, ne sont pas formellement considérées comme des activités bancaires, donc échappent légalement aux réglementations prudentielles (Bâle I, Bâle II) relatives aux fonds propres. Les acteurs en sont les banques d'affaires (Lehman Brothers, Bear Sterns, Goldman Sachs…), les fonds d'investissements (hedge funds), les firmes spécialisées en "titrisation", les compagnies hors bilan immatriculées dans des paradis fiscaux, etc. -- une liste non exhaustive, mais qui suffit à tracer l'ADN spéculatif de ce secteur. La frontière avec la finance "officielle" n'est pas étanche, puisque le shadow banking, ne disposant pas de dépôts, tire ses liquidités d'une sorte d'échange tripartite : de grandes institutions disposant d'une trésorerie importante (caisses de retraite, assureurs) souscrivent des produits financiers élaborés par les banques d'affaires, lesquelles accordent à leur tour des prêts ou des portages à leurs clients. Par ailleurs, les pistes sont brouillées par les banques "universelles" (comme le trio français précité) qui couvrent tout l'éventail des activités financières, qu'elles soient régulées (banques de détail, prêts aux particuliers et aux entreprises...) ou non régulées (trading, spéculation sur les devises ou les taux d'intérêts, gestion de patrimoine...) [Notons que le Glass-Steagall act de 1930, qui obligeait à séparer les activités de dépôt et d'investissement, aurait permis d'interdire un tel mélange des genres, mais il a été abrogé par l'administration Clinton dans les années 90]. Toujours est-il qu'en termes de volume d'affaires et de valeurs (que le Conseil de Stabilité Financière évaluait en 2007 à 60 000 milliards $, l’équivalent du PIB mondial), la finance de l'ombre fait maintenant au moins jeu égal avec la finance officielle. Or elle porte en elle des virus systémiques mortels, qui se sont manifestés avec les subprimes comme ils vont sans doute se manifester avec les dettes souveraines.
Des virus chez les « quants »
On s'excuse d'entraîner maintenant le lecteur, pour la bonne cause (mais, qu'il se rassure, pour un temps seulement), dans une chasse un peu ardue aux virus créés dans les éprouvettes des "quants", ces apprentis-sorciers de la finance. On peut dire que l'ingénierie financière est née au début des années 80 avec les produits dérivés, conçus à l'origine comme des contrats bipartites permettant d'assurer contre des risques très divers (fluctuations des cours de matières premières, aléas climatiques, variations des taux de change, défauts de paiement, etc.) des actifs, appelés sous-jacents, eux aussi très divers (classiquement, une unité négociable d'une matière première, la réalisation d'un événement prévu dans un contrat, etc.; moins classiquement, un taux de change, un taux d'intérêt, une obligation, une action, un indice boursier, etc.) Croissant à des taux à deux chiffres, les produits dérivés constituent aujourd'hui l'essentiel de l'activité des marchés financiers. Leur succès tient bien sûr à la variété multiforme des produits sous-jacents (qui semble n'avoir de limite que l'imagination des contractants), mais aussi, de notre point de vue, à la possibilité qu'ont ces sous-jacents d'être virtuels, c'est-à-dire de ne pas exister encore à l'instant de la transaction. On imagine aisément ce qu'une telle virtualité peut engendrer comme dérives spéculatives (mise de fonds minimale, effet de levier, paris sur les flux...) Un virus mutant nous intéressera spécialement : il s'agit du CDS, ou credit default swap, conçu dans les années 90 par les "quants" de J.P. Morgan Chase. Un CDS est un produit dérivé dont le sous-jacent est un crédit ; on peut le considérer en première approximation comme une assurance contre le risque de crédit d’un émetteur d’obligations, c'est-à-dire un transfert de risque. Dans le schéma traditionnel de l'activité bancaire, c'est le banquier qui analyse les risques d'un crédit et l'assume en cas de prêt ; s'il s'est trompé dans sa gestion des risques, c'est son capital qui encaisse les pertes. Le CDS constitue véritablement un "changement de paradigme", puisqu'en dispensant le prêteur d'assumer le risque complet d'une transaction et en lui évitant d'augmenter ses capitaux de garantie, il permet en pratique aux banques de se transformer en courtiers en crédits, hors réglementation qui plus est. Pas étonnant qu'on ait assisté à un transfert massif de risques de crédit détenus par des banques d'investissement (au premier rang desquelles Lehman Brothers) vers d'autres institutions financières telles que les banques commerciales, les caisses de retraite et les compagnies d'assurance. Le marché des CDS est ainsi passé de 6 400 milliards $ en 2004 à 58 000 milliards en 2007. Mais il y avait deux virus dans la bulle :
- le premier, spécifique au marché américain, c'était les subprimes ("en dessous des premiers"), ces crédits hypothécaires immobiliers pourris fourgués en toute connaissance de cause à des emprunteurs insolvables et auxquels s'adossait une grande partie des CDS. Il faut préciser que le sous-jacent d'un CDS ne se compose pas d'un seul crédit, au sens de la finance de papy, mais d'une multitude de crédits découpés en "tranches" d'ABS (asset-backed security) et réassemblés dans un "véhicule spécial" (SPV, special purpose vehicle), ici un instrument de dette appelé CDO (collaterized debt obligation). Après cette opération de "titrisation", les banques d'affaires replaçaient auprès de leurs clients ces « obligations collatéralisées » (le produit sous-jacent), faisant d'une pierre deux coups : se débarrasser des actifs toxiques et faire souscrire des CDS (les produits dérivés) [tous les termes entre guillemets sont ceux du jargon financier]. Malgré leur sophistication, ces échafaudages spéculatifs, quand ils s'appuyaient sur des fondations pourries comme les subprimes, n'étaient au fond que des "pyramides de Ponzi" 2 déguisées. Mais si leur effondrement a ébranlé le système en entier, c'est à cause de l'infection véhiculée par les CDO et CDS - une "démultiplication de la toxicité", selon le Wall Street Journal, dont toutes les métastases ne sont pas encore connues à ce jour.
- le second virus est consubstantiel à la virtualité déjà signalée du sous-jacent d'un produit dérivé. Le concept de CDS pousse jusqu'au bout cette logique de virtualité, puisque dans ce type de contrat, il n'est nullement requis de l'assuré qu'il possède le produit qu'il cherche à assurer. Normalement, n'est-ce pas, vous ne pourriez pas prendre une assurance-auto sur la voiture de votre voisin. Avec un CDS, si. C'est l'exemple imagé que donnent les économistes de ce qu'ils appellent une "position nue", quand le contractant d'un CDS ne détient pas l'instrument de dette contre le risque duquel il "s'assure". Le CDS efface ainsi la frontière entre l'assurance et le pari, c'est-à-dire la spéculation. Le mécanisme est démonté en détail dans le best-seller de Michael Lewis, The Big Short ( [L]), probablement le meilleur ouvrage grand public sur la crise des subprimes. Dans ce livre qui se lit comme un roman, l'auteur montre comment une poignée de spéculateurs (tous authentiques), ayant vu la faille dans le système, ont "shorté" le marché (dans le jargon boursier, pris une position pariant sur la baisse) en achetant des montagnes de CDS. Et ont fait des Himalayas de profits en touchant leur "assurance" quand le marché s'est effectivement effondré. Ce n'est évidemment pas cette poignée, à son échelle, qui a accéléré la chute, mais bel et bien les banques elles-mêmes qui, non contentes de fourguer à leurs clients leurs CDO toxiques, se mirent aussi, mais à leur échelle, à "shorter" le marché des CDS !
Si l'on est revenu en détail sur la crise des subprimes, c'est que les mécanismes en sont maintenant bien connus, et qu'on ne doute pas que ce sont les mêmes qui sont à l'oeuvre aujourd'hui dans la crise des dettes souveraines : face à un Etat en difficulté, le spéculateur contracte des CDS en position "nue" sur sa dette ; la demande accrue de contrats est interprétée par "le marché" comme une aggravation de la dette, d'où une dégradation de la "note souveraine" du débiteur, une hausse des taux sur ses emprunts, ainsi qu'une hausse du prix des contrats puisque le risque aura augmenté ; le spéculateur peut alors, soit revendre ses CDS avec bénéfice, soit en acheter d'autres pour pousser carrément au défaut de paiement et toucher son "assurance", avec un coefficient multiplicateur à plusieurs zéros. On ne peut pas interpréter autrement la spirale qui est en train d'aspirer la Grèce, et avec elle toute la zone euro si jamais la Grèce fait défaut. L'explication par le seul risque systémique bancaire ne suffit pas. L'exposition des banques aux dettes souveraines, telle qu'elle apparaît dans leur bilan (voir ci-dessus), n'est rien en comparaison de leur exposition hors bilan, puisqu'une étude du FMI de novembre 2011 estime le montant au niveau mondial des contrats CDS souscrits pour ces dettes à plus de 37 000 milliards $, plus du double du PIB européen ! Il s’agit bien sûr de flux, dont les multiples allers-retours nourrissent la finance, mais s’ils devaient être « réalisés », lors d’une crise par exemple… C'est cette échelle astronomique qui permet au "marché" de défier les Etats. On en a eu la preuve au détour d'un communiqué lors du sommet de novembre, quand on a appris que les dirigeants du G20 devaient négocier pied à pied avec les banques pour qu'elles acceptent de renoncer à 50% de leurs créances grecques. Pourquoi négocier ? Pourquoi ne pas tout simplement restructurer la dette grecque (auquel cas les banquiers auraient perdu leur chemise) ? Tout simplement parce qu'une telle restructuration aurait été interprétée par les marchés financiers comme un "événement de crédit" susceptible de déclencher le paiement des assurances - et une crise comparable à celle des subprimes.
« Credit Card Nations »
La force de frappe des marchés financiers, on l'a vu, est assez redoutable pour accréditer l'hypothèse d'un effet de dominos qui bousculerait l'un après l'autre les Etats européens. En cet automne 2011, tous les PIIGS européens (c'est-à-dire les "cochons" précités plus l'Irlande) sont dans l'oeil des spéculateurs, et la France aussi probablement, puisqu’en dépit de sa note officielle AAA (on y reviendra), elle "décroche", comme on dit en cyclisme, du peloton nordique, en particulier de l'Allemagne. L'examen des écarts en novembre entre les taux des emprunts à 5 ans des différents pays révèle d'ailleurs les tensions centrifuges qui s'exercent sur la zone euro : Allemagne 1,3%, France 3,04% (un « spread » de près de 2 points, du jamais vu!), Grèce 45,85% (source GECODIA). Le taux grec est extravagant, quand on sait ce que c’est que la loi exponentielle (voir plus loin). D’ailleurs, quand le prix annuel d’une couverture CDS de cinq ans sur 10 000 E d’obligations grecques dépasse maintenant 2 000 E, on doit conclure que "le marché" parie déjà sur un défaut total de la Grèce. Même la « vertueuse » Allemagne commence à avoir des difficultés, puisqu'elle n'a réussi à lever que 3 milliards E sur 6 pour son dernier emprunt à cinq ans. A ce compte-là, les soigneurs rejoindront bientôt les malades dans les hôpitaux de la finance. Il faut dire que la spéculation frappe des pays qui ne se sont pas encore remis de la saignée financière de 2008, le refinancement des banques et les divers plans d’aide ayant fait exploser les limites du « pacte de stabilité » européen : quand les « critères de convergence » de Maastricht fixaient pour chaque Etat un maximum de 60% du PIB pour la dette publique (et de 3% pour le déficit budgétaire), en 2011 même les pays européens les plus riches vont crever le plafond, 81,7% pour l’Allemagne et 85,4% pour la France (à titre d’information : Grèce 162,8%, Italie 120,5%, Irlande 108,1%, Belgique 97,2%, Royaume-Uni 84%, etc. – source : Commission européenne). Une note du FMI prévoit même pour 2014, malgré les proclamations de bonnes intentions des intéressés, des dépassements « à l’italienne », de l’ordre de 120%. Mais faut-il rappeler qu’à partir de 2004, déjà, les critères de Maastricht n’étaient plus respectés ? L’arbre de la crise ne doit pas cacher la forêt de la dette : les déficits sont devenus une maladie chronique des pays développés.
On espère ne pas abuser de la patience du lecteur en changeant un moment de continent, mais le patient-zéro de cette maladie, le primo-infecté au sens épidémiologique, on le connaît bien, c’est Captain America. Le 15 novembre dernier, la dette publique américaine franchissait le seuil symbolique des 15 000 milliards $, soit 99% du PIB. Tout aussi symboliquement, la semaine d’après, le « super-comité » mixte du Congrès créé pour définir un plan d’économies budgétaires de 1 200 milliards $ sur 10 ans, était officiellement dissous sans être parvenu à un accord. Comment le pays du « rêve américain » est-il devenu en quelques décennies une « credit card nation » ? Rétrospectivement, on peut faire remonter la bifurcation aux années Reagan. Le président républicain avait été élu pour sortir le pays d’une décennie 70 perçue par les Américains comme une période de déclin (baisse du dollar, inflation, chômage, scandale du Watergate, défaite au Viet Nam, humiliation en Iran…) Il y parvint effectivement, au prix d’une politique néo-libérale agressive s’appuyant sur les multinationales, les délocalisations, la consommation de masse dopée par les importations… et le crédit. Le marketing, les médias et la finance martèlent le triple credo « liquidités-dettes- effet de levier », et c’est Alan Greenspan, nommé président de la Réserve Fédérale au début du second mandat Reagan, reconduit ensuite par Bill Clinton, qui l’entérine par sa politique de cheap money. Paul Jorion a finement analysé la philosophie sous-jacente du crédit considéré comme moteur, non seulement de la consommation, mais de toute l’activité économique. « Il ne gagne que 3 000$ par an… mais il vaut 112 290$ », affirme un prospectus [des années 30 !], comparant les revenus actuels de Jim Jones à ses revenus futurs cumulés selon les principes du calcul actuariel. « Ne serait-il pas sympathique, ajoute l’annonce, que Jim puisse utiliser tout de suite une partie de cette somme ? » Il faut croire que la mantra a fini par imprégner la mentalité collective, puisque des études américaines révèlent ce phénomène étonnant : alors même que les inégalités de revenus n’ont cessé de se creuser (voir plus loin), les statistiques, jusqu’à la crise de 2008, ne montrent aucune hausse significative des inégalités en matière de consommation. Une richesse virtuelle fondée sur le calcul actuariel, mais c’est exactement le mécanisme de base des subprimes (1). Cette attitude, souligne Jorion, s’étend depuis les années 80 à l’entreprise elle-même, « caractérisée par une mentalité d’authentique pillage permanent de sa trésorerie : seront distribués aux actionnaires non seulement les gains immédiats, mais aussi ceux à venir » ([J], pp.64-66). Un exemple frappant est fourni par le scandale Enron, une firme américaine de courtage en énergie, qui attribua par anticipation une centaine de millions $ à deux de ses dirigeants, à valoir sur les gains postulés d’une centrale électrique indienne… qui ne fut jamais construite.
Le triomphe du néo-libéralisme dans les années 90 a diffusé dans les économies occidentales ce modèle de credit card nation qui, s’appuyant en outre sur une mondialisation présentée comme « heureuse », a pu prétendre faire de nous tous des consommateurs « gagnants-gagnants », comme on dit. Dans son livre sur la bulle américaine, J-M. Quatrepoint résume le mécanisme en des termes qui s’appliquent à tous les pays qui ont pu croire à la martingale consumériste : « Les multinationales délocalisent en Chine et importent des produits bon marché [dans les pays occidentaux] ; leurs produits défiscalisés alimentent la sphère financière qui peut jouer, grâce aux effets de levier et aux produits dérivés, avec les flux de milliers de milliards de dollars. La baisse du pouvoir d’achat [des Occidentaux] en termes réels est compensée par la masse du crédit (…) La dette globale [des pays occidentaux], privée et publique, enfle. Mais elle est financée par les excédents commerciaux que les Chinois et les pays producteurs de pétrole transforment [en obligations d’Etat]. Apparemment, la boucle est bouclée. » ([Q], p.37)
La croissance aurait-elle pu nous éviter d’entrer dans ce cercle vicieux ? La croissance, c’est la panacée de l’économie politique parce que le plein emploi apaise les luttes sociales et les recettes alimentent les rouages de l’Etat-providence. Les pays européens ont connu cela, dans la période dite des Trente Glorieuses (grosso modo, de l’après-guerre jusqu’aux premiers chocs pétroliers) où ils croissaient à 5% l’an pour rattraper le niveau de développement américain. Malheureusement s’ensuivirent « Trente Piteuses » de croissance molle et de chômage structurel, et la déprime face aux performances des pays émergents, en particulier de la Chine. Mais le culte de la croissance nous paraît d’une étonnante naïveté :
- d’une part, la croissance forte des Trente Glorieuses correspondait à une séquence de rattrapage, on l’a dit, exactement comme pour les pays émergents aujourd’hui. Or il est évidemment plus facile de croître à un taux rapide quand on part de bas, avec des besoins d’investissement à la fois matériels et humains pour soutenir l’activité ; et qu’on part de loin, avec en ligne de mire un « lièvre » dont on peut copier ou adapter les savoirs technique et organisationnel. C’est une autre affaire, une fois atteint un certain niveau , que d’inventer de nouveaux schémas et modes de développement (qu’ils soient ou non justifiés). Les Etats-Unis dans les années 70, le Japon dans les années 90 l’ont appris à leurs dépens. Nul doute que la Chine en fera l’expérience à court ou moyen terme.
- d’autre part, le postulat d’une
croissance forte et indéfinie n’est pas recevable. Par définition
même du taux de croissance, l’entité qui croît (que ce soit une
dette ou un PIB) n’obéit pas à une loi « linéaire »
(celle qu’on calcule par la règle de trois) mais
« exponentielle ».
Or, surtout sur le long terme, la
seconde est à la première ce qu’une F1 est à une 2 CV !
Prenons l’exemple bien connu de l’échiquier : la légende
raconte que l’inventeur du jeu d’échecs aurait demandé à son
souverain, comme récompense, qu’on mette un grain de riz sur la
première case, puis deux sur la seconde, quatre sur la troisième,
et ainsi de suite. « Rien que
cela ? » se serait
exclamé le monarque. Il a dû déchanter quand toutes les récoltes
de son royaume n’ont pas suffi pour aller jusqu’à la 64ième
case ! Autre exemple : pour la Chine, avec son taux de
croissance de 10% qui fait fantasmer les politiciens, un calcul
rapide - qu’on épargnera au lecteur 3
- montre que son PIB doublerait dans 7 ans, ou encore que dans 21 ans
(70 ans si l’on s’en tenait faussement à la loi
« linéaire »),
il ferait près du triple du PIB actuel de l’UE . Pour pousser les
choses jusqu’à l’absurde, dans 98 ans, c-à-d. en l’an 2109,
il serait multiplié par 11 389 (il faudrait 163 830 ans en
« linéaire »), autrement dit, toutes les ressources du
globe n’y suffiraient pas !
La réponse à la question du début est donc qu’elle n’a pas de sens. Que c’est plutôt la trinité « liquidités-dettes-effet de levier » qui a été conçue pour essayer de retrouver le Paradis Perdu de la croissance. Ironiquement, l’un des « shorters » interviewé par M. Lewis (op. cit.) avait proposé, au milieu de l’incompréhension totale de ses clients, d’appeler son fonds d’investissement « Milton’s Opus » 4.
Néo-libéralisme et « marché »
Nous reviendrons plus loin sur les responsabilités des Etats et des citoyens devenus « accros » à la croissance, mais tout ce que nous avons exposé jusqu’ici de la crise converge logiquement vers un réexamen de l’idéologie néo-libérale qui nous régente depuis l’effondrement du « socialisme réel ». Quelle est cette doxa ? Depuis trois décennies que toutes les économies développées du monde s’appuient sur le trépied commun « capitalisme-économie de marché-libéralisme », nous avons fini par mettre inconsciemment ces trois concepts ensemble dans une seule catégorie. Après la chute du Mur, certains théoriciens de « la fin de l’Histoire » se sont même permis d’y inclure la démocratie. Or :
« Le capitalisme est un système de répartition du surplus économique (c-à-d. la richesse nouvellement créée) entre les trois grands groupes d’acteurs que constituent les salariés, qui reçoivent un salaire, les dirigeants d’entreprise (entrepreneurs ou industriels), qui perçoivent un bénéfice, et les investisseurs ou actionnaires, qui procurent le capital et perçoivent des intérêts ou dividendes 5. L’économie de marché est le système qui assure la distribution des marchandises du producteur au consommateur, accordant au passage un profit au marchand (les marchands constituant le quatrième groupe d’acteurs). Le libéralisme est une politique visant à optimiser le rapport entre les libertés individuelles et l’intervention de l’Etat dans les affaires humaines en vue de protéger ces libertés » ([J], p.28). Cette dernière définition, somme toute assez neutre, doit être précisée car depuis au moins le siècle des Lumières, le « libéralisme » a revêtu diverses significations, parfois antagonistes. Pour ne pas discuter sur le sexe des anges, on donnera ici à ce mot la signification commune qu’il a aujourd’hui (en dehors du monde anglo-saxon), à savoir une philosophie politique qui, au nom de certaines libertés telles que la responsabilité ou le droit de propriété, veut réduire le champ régalien de l’Etat, quitte à le cantonner au rôle de « veilleur de nuit » ; une pensée économique qui, au nom des mêmes principes, bannit toute ingérence de l’Etat susceptible de perturber « l’équilibre général du marché », où seule doit agir la « main invisible ».
Le « consensus de Washington »
Il s’agit de la formulation non
officielle, rédigée par l’économiste John Williamson dans un
article de 1989, d’une doctrine qui entend déployer le libéralisme
dans le monde entier, selon dix orientations proposées à tous les
gouvernements :
1) Contenir les déficits
publics
2) Réorienter les priorités en
matière de dépenses publiques
3) Réformer la fiscalité
4) Libéralisation financière
5) Adoption d’un taux de change unique et compétitif
6) Libéralisation des échanges
commerciaux 7) Elimination des barrières à l’investissement
direct étranger
8) Privatisation des entreprises publiques
9) Dérégulation des marchés pour
assurer l’élimination des barrières à l’entrée et à la
sortie
10) Sécurisation des droits de propriété.
Toutes ces propositions ont été en quelque sorte entérinées par le traité européen de Lisbonne (2007)
Revenons à notre propos. Le libéralisme invoque la « naturalité » de ses revendications, mais se garde bien de préciser les critères permettant de situer le point optimal entre les libertés individuelles et l’action de l’Etat. Comme le note P. Jorion, dans la pratique, le libéralisme fait comme s’il excluait a priori l’hypothèse que l’intervention de l’Etat puisse déjà se trouver à un niveau optimal, encore moins à un niveau insuffisant ; en vertu de quoi elle doit toujours être revue à la baisse -- jusqu’à l’extinction de l’Etat s’il le faut, dans les versions extrêmes que sont l’ultra-libéralisme ou l’anarcho-capitalisme. C’est en tout cas à la tâche de bouter l’Etat hors du « marché » que s’est attelé le néo-libéralisme des années Thatcher-Reagan, quand il a pris la relève des politiques keynesiennes défaillantes. Ses principes, sous-entendus dans le « consensus de Washington » (voir encadré), irriguent, depuis, la « pensée unique » de la gouvernance économique mondiale. TINA, disait la Dame de Fer. Ce n’était pas le nom de sa banquière, mais l’acronyme de sa réponse à toute discussion : « There is no alternative ». Le néo-libéralisme pousse jusqu’au bout le postulat de l’infaillibilité de la « main invisible » : le « marché » est auto-régulé, le chômage est « naturel », l’Etat-providence est responsable de l’inflation et de la perte de compétitivité des entreprises… Sans prétendre être systématique, examinons ces différents points.
Le lecteur attentif aura sûrement remarqué, depuis le début, la différenciation typographique que nous faisons entre les marchés (sans guillemets), qui sont des lieux ou des institutions bien repérables où s’effectuent les transactions financières, et le(s) « marché(s) » (avec des guillemets), cette entité indéfinie mais omnisciente dont la théorie libérale nous vante les « anticipations rationnelles ». Paradoxalement, c’est Robert Skidelsky, le biographe de Keynes, qui a donné une explication sociologique pertinente de la croyance libérale dans la rationalité du « marché » : « L’histoire des « anticipations rationnelles » est liée à la nature démocratique du rêve américain. Les marchés, représentant le verdict de millions d’individus poursuivant leur intérêt égoïste, produisent un savoir plus vaste et de meilleure qualité que celui dont disposent les gouvernements (…) Les partisans de l’hypothèse des anticipations rationnelles aiment à souligner le caractère démocratique du postulat de rationalité. Il est fondé sur la loi des grands nombres, qui veut que plus le groupe est vaste, plus il est probable que le choix moyen sera optimal. Il n’existe pas de moyen connu pour un gouvernement d’être plus avisé que la foule dans sa masse ». L’omniscience prêtée au « marché » implique que celui-ci connaît la « vérité des prix », le fondement même des échanges, mais en pratique, quelqu’un a-t-il le numéro de téléphone de l’oracle ?
Certains répondent par une tautologie, comme le patron de Goldman Sachs, L. Blankfein, lorsqu’il dut se défendre en avril 2010 contre l’accusation de fraude portée par la SEC (le gendarme boursier américain). Amené à expliquer le rôle du banquier, il le présenta comme réduit à la fonction de « teneur de marché » (market maker), c-à-d. d’intermédiaire commercial entre acheteurs et vendeurs. Selon Blankfeld, non seulement la qualité du produit échangé ne concerne pas (irrelevant) l’intermédiaire, mais l’acheteur non plus ne devrait pas s’en préoccuper, parce que le niveau auquel le marché fixe son prix évalue cette qualité correctement. En fin de compte, ce que l’acheteur « averti » (sophisticated) achète, c’est du risque, et le « marché » fait en sorte -- en principe -- que les intérêts alloués reflètent effectivement le risque encouru. Autrement dit, acheteur et vendeur ne connaissent peut-être pas la vérité des prix au moment de la transaction, mais ils la connaîtront après, à leurs risques et périls (perte ou bénéfice). Tout au plus Blankfeld veut-il bien admettre que pour une évaluation correcte des risques, le marché doit faire montre de transparence (c’est le mot magique néo-libéral qui remplace la réglementation).
D’autres rebondissent sur le concept de transparence. Faute d’une information complète, et pour éviter une information asymétrique (le délit d’initié), les marchés ont inventé les notations, confiées à des agences dont le métier est d’évaluer les risques de défaillance suivant des méthodes scientifiques - les fameuses « mathématiques financières » 6 - et d’en donner une classification publique par des notes - les fameuses triples lettres. Par exemple, une obligation notée AAA devrait avoir moins de 1 chance sur 10 000 de défaillir durant sa première année d’existence, BBB moins de 1 chance sur 500, etc. Les trois principales agences de notation, par ordre d’importance décroissant Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, toutes trois basées à New York, profitent d’un monopole de fait ; bien qu’elles ne jouissent d’aucun statut officiel, leurs bulletins de notes (ratings) sont attendus comme les oracles de la Pythie : pour fixer les limites des placements des caisses de retraite ou des assureurs, pour calculer les ratios des fonds propres des banques, pour déterminer les levées de capitaux des banques… et pour faire monter ou descendre les taux d’intérêt des emprunts d’Etat. On connaît cette boutade : « Il existe seulement deux puissances capables de détruire l’économie d’un pays : l’aviation américaine en l’écrasant sous les bombes… et Moody’s en dégradant sa notation ». Bien que les « Trois Sorcières », répétons-le, n’aient aucun statut officiel, des Etats-Unis à l’Union Européenne en passant par les pays émergents, toutes les puissances économiques de la planète reconnaissent leur imperium et tremblent devant leurs oukases. Elles ont abaissé la note des USA et de la moitié des pays de la zone euro, elles ont mis l’autre moitié sous surveillance… et pourtant elles se trompent plus souvent qu’à leur tour, du scandale des caisses d’épargne américaines à la faillite de Parmalat, et pour finir, le fiasco des subprimes. Mais qui les a faites reines (ou sorcières) sinon les Etats eux-mêmes, quand ils ont abandonné leurs prérogatives de régulation et de réglementation pour se soumettre au verdict du « marché » ? Il est pourtant instructif de connaître les avis des acteurs des marchés eux-mêmes, tels qu’ils ont été recueillis par M. Lewis dans The Big Short : pour les traders et autres gestionnaires de hedge funds, « les types qui ne trouvent pas de boulot à Wall Street vont bosser chez Moody’s ». En particulier, concernant les agents chargés de l’évaluation des obligations subprimes, les appréciations vont de « moins pires » à « abrutis finis » (p.134). « Les salles de marché obligataire de Wall Street, remplies de personnes qui gagnaient chaque année des montants à sept chiffres, décidèrent donc d’embobiner lesdits abrutis, qui ne gagnaient que des montants à cinq chiffres, pour qu’ils accordent la note la plus élevée possible aux pires prêts imaginables (…) Ils ne mirent pas longtemps à comprendre, par exemple, que non seulement les gens de chez Moody’s et S&P n’évaluaient pas les prêts immobiliers individuellement, mais qu’ils ne les regardaient même pas. Tout ce que eux et leurs modèles voyaient et évaluaient, c’étaient les caractéristiques générales des assemblages de prêts [des CDO](…) Moody’s et S&P demandaient aux traders qui assemblaient les prêts non pas le score FICO [mesurant la solvabilité individuelle] de chaque emprunteur, mais le score moyen de l’assemblage dans sa totalité ». Or n’importe quel collégien peut comprendre que si un smicard monte dans le même avion que Bill Gates, la moyenne des revenus des passagers de l’avion fait automatiquement du smicard un homme riche. « Les modèles utilisés par les agences de notations étaient truffés de failles de ce genre ». C’est ainsi que les « sept chiffres » réussirent à embobiner les « cinq chiffres » et à faire classer AAA des CDO pourris. Embobiner vraiment ? « A en juger par leur comportement, toutes les agences de notation ne pensaient qu’à une chose : maximiser le nombre de titres qu’elles évaluaient pour les banques d’investissement de Wall Street, et engranger les commissions » (p.202). A titre d’information, en 2011, la marge opérationnelle de Moody’s est de 40%, celle de S&P (la mal nommée) de 43%, celle de Fitch, de 58%. Au vu des témoignages d’incompétence (modèles grossiers, erreurs grotesques), voire de vénalité (course aux commissions, conflits d’intérêts), c’est la note des agences de notation qu’on devrait dégrader. Du coup, la course des politiques derrière le triple A (surtout en France, où le bégaiement AAA résume l’action sarkozyste) devient elle-même suspecte. Après les démentis apportés par les crises aux prétendus bienfaits de la déréglementation, le triple A ne serait-il pas la dernière feuille de vigne utilisée pour masquer, à l’intérieur des Etats, la poursuite obstinée de la soi-disant « révolution libérale » ?
Néo-libéralisme et société
Pour les néo-libéraux, de Milton Friedman à Friedrich Hayek 7, l’ennemi philosophique à abattre, c’est l’Etat régulateur et répartiteur. Un titre de Hayek, Misère de la justice sociale, ne laisse aucun doute à ce sujet. Mais on ne peut discuter sérieusement de justice sociale sans se pencher d’abord sur les contradictions internes de la formule fondatrice du pacte républicain, « Liberté, égalité, fraternité ». Admettons, même en l’absence de perfection, que les libertés individuelles sont acquises et protégées par l’Etat de droit dans les démocraties modernes. Reste que le principe d’égalité n’est pas contenu dans celui de liberté. C’est un débat ancien, puisque Lacordaire s’écriait déjà en 1848 : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». Or dans une société fondée sur le capitalisme et l’économie de marché, l’inégalité première, c’est bien entendu celle des revenus, plus précisément, l’inégalité de la répartition entre les producteurs de ce qu’on a appelé plus haut le surplus économique. Le seul revenu du salarié provient de la location de sa force de travail. Ne pas confondre avec son travail, celui qui crée le surplus, la différence constituant une plus-value que se partagent les trois autres acteurs, le capitaliste (dividendes), l’entrepreneur (bénéfices) et le marchand (profits). Ceux qui douteraient de la pertinence de la notion de plus-value n’ont qu’à tourner leur regard vers « l’atelier chinois du monde » pour en trouver l’illustration la plus crue. Dans le partage du surplus économique, qui se fait en fonction de rapports de forces, c’est la position du capitaliste qui prédomine, selon le principe simple que traduit l’adage populaire « L’argent appelle l’argent », et ce mécanisme conduit automatiquement à ce qu’on appellera par commodité une accumulation du capital (5), au sens d’une augmentation des stocks de capitaux et de leur concentration entre les mains d’un nombre de plus en plus restreint de capitalistes. Dans la société néo-libérale qu’on a vue se développer au cours des Trente Piteuses, la position du salarié, à l’inverse, n’a pas cessé de s’affaiblir, à cause de la conjonction de plusieurs facteurs :
- la raréfaction du travail dans les pays développés, due à la fois au progrès technique (automation, informatisation) et à la délocalisation (la globalisation permettant d’accéder à une réserve inépuisable de force de travail, l’emploi devient une « variable d’ajustement »)
- la montée en puissance du secteur marchand, suite à la mondialisation du commerce, et qu’atteste par exemple, dans les économies développées, le poids acquis par la « grande distribution »
- le développement d’un nouveau type de capitalisme, dit « actionnarial », en général étroitement associé à la finance, et qui efface les frontières définies plus haut entre capitalistes et entrepreneurs en alignant, par le biais des « stock options » et autres incitations, les intérêts des seconds sur les premiers
- l’effondrement du « socialisme réel » qui a fait disparaître, non pas un contre-modèle (c’était plutôt un repoussoir), mais un contre-poids, il faut bien le dire, dans un rapport de forces
Ainsi, au lieu que la richesse
créée par le progrès technique et la globalisation profite à
l’ensemble de la société, elle a été en réalité captée par
une fraction seulement des acteurs économiques. Face à cette
coalition, jamais le monde salarial ne s’est retrouvé aussi
démuni, et la classe moyenne « se vide par le bas ».
L’inégalité accrue dans la répartition du surplus peut se lire
par exemple dans une étude de Michel Husson (citée dans [J]) sur la
rentabilité des grands groupes français sur la période 1992-2007,
où il apparaît que l’augmentation de la rentabilité est due pour
l’essentiel à un recul considérable de la part des salaires dans
la valeur ajoutée, de 66,4% à 54,8%, soit une baisse de 11,6
points. Au sujet des inégalités tout court, le livre de Thierry
Pech, Le Temps
des Riches ([P]), révèle des
statistiques proprement renversantes (INSEE, 2008). Prenons
comme point de référence le revenu
médian français, c-à-d. celui qui sépare la
population en deux parties égales [ne pas confondre avec le revenu
moyen ; voir plus haut], et qui est d’environ 1 600 E par mois
et
par personne (après impôts et prestations sociales). En suivant
Eurostat et en fixant le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian,
on trouve en France -- la seconde économie européenne -- près de 8
millions de pauvres, soit environ 13% de la population. Pour la
richesse, il n’y a pas de seuil Eurostat, mais l’INSEE définit
arbitrairement les bénéficiaires de hauts revenus (délicatesse de
langage) comme étant ceux qui font partie des 10% les plus aisés de
la population. Notons qu’il est question seulement de revenus, pas
de patrimoines. Surprise : on entre dans le « top 10% »
français à partir de 3 000 E par mois, soit un peu plus du double
du revenu médian, un seuil d’accès somme toute assez modeste.
Mais ce n’est qu’un seuil minimal, au-dessus duquel l’échelle
des revenus explose littéralement : « top 5% », 5
400 E ; « top 1% », 10 000 E
(580 000 personnes environ) ;
« top 0,01% », 82 000 E (5 800 personnes environ). Sans
surprise, la dernière tranche, l’élite des élites, est
constituée à 50% de cadres de la finance. Et l’on ne parle ici
que des revenus déclarés. Comme le dit Pech, « on n’approche
pas de la véritable richesse en gravissant un à un les degrés
réguliers d’une échelle, car tout en haut, c’est la continuité
de l’échelle qui est rompue » ([P], p.29).
L’égalité, c’est entendu, ne peut pas figurer dans l’ADN d’une société où un individu peut gagner en un an ce qu’un autre ne gagnera pas en une vie. Mais les néo-libéraux (et les sociaux-libéraux à la Blair) ont une réponse toute prête pour justifier l’inégalité : c’est la thèse du « ruissellement » (trickle down), formalisée par John Rawls en 1971 dans A Theory of Justice, qui soutient en gros qu’un accroissement des inégalités demeure acceptable si l’effet dynamique produit par la concentration des richesses profite aussi in fine aux pauvres, par le biais de la création de nouvelles entreprises, de nouvelles industries, de nouvelles richesses. En termes imagés, la richesse « ruisselle » du haut de la pyramide vers le bas. Soit, acceptons de discuter de cette « loi hydraulique » du strict point de vue de l’efficacité économique. Que constate-t-on en regardant l’histogramme du développement des pays riches ? Contrairement aux promesses du « ruissellement », la croissance des hauts revenus et celle de l’économie globale se font en sens inverse l’une de l’autre: ainsi de 2001 à 2007, les revenus des Français ont augmenté de 9% à la base et de 40% à la pointe, alors que le rythme global de l’économie a reculé de 0,7 point par rapport aux 7 années précédentes. En remontant le temps sur une plus longue période, l’étude de Thomas Piketty sur Les hauts revenus en France au 20ème siècle (citée dans [P], p.49) montrent, alors que les deux guerres mondiales avaient « euthanasié les rentiers », que les hauts revenus se remettent à progresser pendant les Trente Glorieuses, mais moins vite que le taux de croissance (5,5%) de l’économie, puis, plus vite que ce taux pendant les Trente Piteuses. Une étude analogue de Piketty et Saez (op. cit.) révèle la même évolution aux USA, où, à partir des années 80, les inégalités américaines ont retrouvé en deux décennies le niveau qui était le leur à la veille de la Première Guerre. On peut penser raisonnablement que l’accumulation du capital, au sens défini plus haut, rompt l’équilibre délicat entre production et consommation qu’une économie de marché capitaliste est constamment obligée de maintenir sous peine d’inflation ou de chômage. La concentration excessive de stocks de capitaux équivaut indirectement à une moindre disponibilité, et l’énormité de ces stocks amène les investisseurs, pour qu’ils ne se déprécient pas du fait de l’inflation, à les placer sur le marché financier – ce qu’ils font d’autant plus volontiers que dans une économie post-industrielle, les profits proviennent plus des flux financiers autour d’un produit que du produit lui-même. Cet argent soustrait à la consommation, d’une part alimente la spéculation sur les fluctuations de prix, d’autre part engendre une conjoncture de surproduction qu’il faut combattre par une politique concertée de « consumérisme » (publicité et crédit). Or la grande masse des consommateurs reste celle des salariés, dont une partie des revenus, déjà rognés (voir plus haut), sera ainsi divertie en paiement d’intérêts, qui diminueront d’autant le pouvoir d’achat… et augmenteront d’autant l’accumulation du capital. La boucle est bouclée, et si vraiment « ruissellement » il y avait, ce serait un ruissellement vers le haut, défiant les lois de la gravité.
Sans même parler d’Etat-providence, la mission de tout Etat digne de ce nom serait de chercher à réguler n’importe quel mécanisme susceptible de gripper le fonctionnement de son économie. Il devrait donc par exemple freiner la concentration des richesses précédemment constatée par une politique fiscale efficace. Or, dans l’Etat libéral, on constate l’inverse, de Reagan-Thatcher à Chirac-Sarkozy. Pour une fois on n’ennuiera pas le lecteur avec des chiffres, le phénomène central étant ici que « le formidable relâchement du frein fiscal sur les plus aisés depuis vingt ans est le fait de décisions politiques, non seulement parfaitement démocratiques, mais bien souvent soutenues par un refus largement répandu de l’impôt. Cette contradiction qui traverse l’ensemble du corps social est la signature de notre temps. Elle met aux prises les imaginaires de la solidarité et de la compétition » ([P], p.13). La solidarité remplace le mot un peu daté de fraternité dans la devise républicaine. Elle accompagne la lente genèse de la « société salariale » comme réponse à la vulnérabilité des prolétaires du 19ème siècle et du début du 20ème : le développement du droit du travail (épaulant le salarié dans son rapport de force inégal avec son employeur), la création de grands collectifs protecteurs (confédérations, syndicats), la construction d’assurances sociales (contre la maladie, les accidents, le chômage)… c’est tout cela qui a donné son autonomie à « l’individu salarial ». Mais dans la société néo-libérale, « cet équilibre entre quête d’autonomie et appui de collectifs protecteurs a été rompu, engendrant une nouvelle mutation de l’individualisme » (op. cit.). Parfaitement incarné dans le Bernard Tapie des « années-fric », ce nouvel avatar est un « individualiste compétiteur » dénué de toute consistance morale, lesté d’un appétit obstiné de richesse mais délesté de toute idée de dette sociale. Quelle est donc cette dette sociale ? Le philosophe du 19ème siècle Léon Bourgeois (cité dans [P]) la définit comme étant l’immense « outillage matériel et intellectuel » où peut (doit) puiser chaque individu qui vit au sein d’une société : l’agriculture qui le nourrit, les bâtiments qui l’abritent, l’école qui l’instruit, la médecine qui le soigne, la connaissance scientifique et philosophique qui l’élève au-dessus de l’état de nature… Dès sa naissance, l’individu social monte sans s’en apercevoir sur les épaules des géants qui l’ont précédé, pour paraphraser la formule célèbre de Newton. Passant de l’individu à l’entreprise, on remarque pareillement que le développement économique, même du point de vue libéral, ne se fait pas ex nihilo, mais en s’appuyant sur les infrastructures sociales d’un Etat-nation, qui fournissent le capital humain (éducation, santé publique) et les institutions (marché organisé, Etat de droit), deux apports sans lesquels le capital ne serait que de l’argent qui dort (comparer par exemple l’Afrique du Sud et le Swaziland). En résumé, aucun individu vivant au sein d’une société, aucune entreprise se développant dans cette société ne peuvent se prétendre déliés de toutes les interactions humaines. Or c’est une telle déliaison de la solidarité qui est implicitement à l’œuvre dans le culte néo-libéral de la performance et de la réussite 8. La société ultra-libérale, ce sera celle que redoutait Oscar Wilde, où « tout a un prix et rien n’a de valeur ».
Crise de l’euro, de l’Europe ou de la démocratie ?
D’après ce qu’on vient d’exposer de ses mécanismes, la crise des dettes souveraines est une continuation directe de celle des subprimes, elle-même engendrée par les excès de la finance, elle-même dérégulée par la pratique néo-libérale. Mais la spécificité (apparemment) européenne de la crise ne manque pas de dérouter.
* Ce n’est pas une crise de l’euro à strictement parler, puisque la monnaie n’est pas attaquée directement. Depuis des mois que la crise s’est déclenchée, l’euro continue à naviguer aux alentours de 1,35 $, alors que, rappelons-le, sa parité à sa création était de 1,16 $, et qu’à l’occasion de certaines crises, elle avait pu descendre en dessous de 0,9 $. Ce à quoi la spéculation s’en est prise, on l’a vu, c’est la dette publique des pays de la zone euro, à commencer par les maillons faibles tels que la Grèce ou l’Irlande. Mais c’est techniquement devenu une crise menaçant l’existence de l’euro quand sont apparus, au fil des assauts des marchés, les défauts structurels cachés dans la construction de la monnaie européenne. La question-clé est la suivante : comment se fait-il que des pays en aussi mauvaise posture, sinon pire, que la zone euro, ne soient pas attaqués ? La dette publique américaine atteint 100% du PIB, dans le même temps que démocrates et républicains s’écharpent au Congrès sur les dépenses sociales à couper ou les impôts à relever. Le Japon, qui détient le record du monde de la dette, 220% du PIB, n’arrive toujours pas à se sortir de deux décennies de stagflation. En Europe même, la Grande-Bretagne, pourtant troisième puissance économique, a tous ses voyants dans le rouge : dette, 84% du PIB ; déficit, 9,4% ; chômage, plus de 8% de la population ; croissance, 0,6%, après deux années de récession. L’agence Moody’s a dégradé les notes américaine et japonaise, elle a mis le Royaume-Uni sous surveillance. Et pourtant les « marchés » ne manifestent aucune velléité de monter à l’assaut. La crise des dettes souveraines porte mal son nom, si l’on ne précise pas qu’il s’agit des dettes de l’Euroland. Les autres pays -- y compris le R-U, qui n’est pas dans cette zone – disposent, eux, de « l’arme atomique » : leur Banque Centrale, qui peut racheter leurs dettes sur le marché secondaire, au besoin en créant de la monnaie. C’est le mécanisme qu’on appelle dans le jargon la monétisation, ou « l’assouplissement quantitatif » (quantitative easing), ou plus vulgairement la planche à billets. On en devine aisément le risque inhérent : la création de monnaie n’ayant de contre-partie dans aucune richesse réelle engendre à terme l’inflation, et si la machine s’emballe, l’hyperinflation, comme celle que l’Allemagne a connue dans les années 1923-24 et qui a contribué à l’effondrement de la république de Weimar et à l’avènement du nazisme. Mais ce risque ne vaut-il pas la peine d’être couru en cas d’urgence ? Depuis des lustres, la Réserve Fédérale américaine (la FED) manie la « planche à billets » avec une maestria reconnue. Pourquoi la Banque Centrale européenne (la BCE) n’en ferait-elle pas de même ? Parce que ses statuts (contenus dans le traité de Lisbonne) le lui interdisent. Son rôle premier officiel (souvenir des années 20) est de surveiller l’inflation, point. Depuis le début de la crise, elle est intervenue ponctuellement pour faire baisser les taux par des rachats sur le marché secondaire, mais ses capacités d’intervention sont limitées par l’obligation de « démonétisation » (reverse repo dans le jargon), c-à-d. de neutralisation, d’une façon ou d’une autre, de l’équivalent de la monnaie qu’elle a injectée par ses acquisitions. On voit clairement l’impasse dans laquelle l’Euroland s’est enfermé.

dessin de Willem (Libération)
* Pour l’observateur extérieur, une solution à court terme serait visiblement un changement du statut de la BCE pour lui permettre d’intervenir par « monétarisation ». Une autre solution proposée serait la possibilité d’émettre des « euro-obligations » (des obligations européennes qui remplaceraient les obligations des Etats séparés), ce qui reviendrait à « mutualiser les dettes ». La solution finalement retenue en octobre 2011 fut la réactivation du Fonds européen de stabilisation financière (FESF), un organisme créé en 2010, qui disposera des prérogatives toujours refusées à la BCE : outre les rachats sur le marché secondaire, ce fonds pourra acheter des obligations sur le marché primaire, c-à-d. auprès des Etats ; il pourra aussi accorder des prêts directement aux Etats ; il sera doté d’une force de frappe de 1000 milliards E, qu’il financera en émettant des obligations garanties par les Etats de la zone euro, ou en empruntant directement à la BCE. On se gardera bien, étant profane, d’émettre le moindre avis sur l’une ou l’autre solution. On se bornera à noter que le montage de cette usine à gaz, qui ne fonctionnera pas avant fin 2011, a nécessité l’accord, l’un après l’autre, des dix-sept Parlements de l’Euroland, et que la minuscule Slovaquie a failli tout faire capoter pour des raisons de basse politique (l’opposition voulant en profiter pour faire tomber le gouvernement). On touche ici du doigt l’un des défauts structurels de fonctionnement de l’UE, la nécessité de prendre des décisions par consensus. S’agit-il d’une maladie infantile ou déjà d’une maladie sénile ? A ce stade, ce que révèle la crise de la dette, c’est bien une crise de gouvernance européenne. Dans le passé, la construction européenne a toujours avancé par ébranlements successifs. Cette fois, l’ébranlement risque d’être cataclysmique. Quoi qu’on en pense, la zone euro est quand même le cœur de l’Union européenne : si elle explose, c’est l’Union qui éclate, c’est l’économie mondialisée qui vacille, c’est le retour aux frontières, aux dévaluations compétitives, à la guerre commerciale… L’existence d’un semblant d’exécutif aurait peut-être permis de régler le problème grec avant qu’il dégénère. Encore eût-il fallu à la barre un capitaine à la hauteur, qui indique un cap et une vision, ce qui n’est certainement pas le cas du capitaine Merkozy. On nous annonçait une « refondation de l’Europe », on eut droit à une « union budgétaire », une mouture renforcée du « pacte de stabilité ». Ce qui nous promet à moyen terme un marathon parlementaire à 27 ou 26, ou 17 ; à court terme, rien. On est en droit de soupçonner des arrière-pensées de politique intérieure. Comme s’il était urgent de réparer -- lentement -- le toit alors que la maison flambe !
On ne sait pas trop comment se dénouera cette crise, même si l’on espère que ce ne sera pas dans le malheur des peuples. Mais à l’heure d’aujourd’hui, elle aura eu au moins un effet positif : l’éveil d’une certaine conscience politique populaire, jusque-là anesthésiée par le consumérisme. Deux facteurs ont pu jouer : le sentiment d’injustice face à la « rigueur » ; le sentiment de révolte né de l’impuissance face aux « marchés ».
* Il ne faut jamais sous-estimer le sentiment d’injustice : voir la brioche de Marie-Antoinette ou le pot de chambre en or de Gogol 9. Que les peuples aient vécu « au-dessus de leurs moyens », peut-être, encore que, contrairement aux « acheteurs avertis » de Blankfein, ils ne savaient pas forcément, en votant, ce qu’on leur vendait comme politique de consommation. Que l’austérité, rebaptisée « rigueur » (un mot avec une connotation morale, faut-il le remarquer) constitue la seule voie de sortie, parce que TINA, soit. Mais la rigueur inégalement partagée, non. Les salariés subissent la crise deux fois plutôt qu’une : sous la forme d’un impôt qui a cessé d’être progressif, et sous la forme de prestations sociales en baisse. Alors que les plus fortunés, non seulement l’Etat leur fait des cadeaux fiscaux (bouclier fiscal, niches fiscales, allègement des droits de mutation…), mais il évite en quelque sorte de les fâcher quand, au lieu de les taxer, il leur emprunte leurs fonds à des taux qui les enrichissent encore plus. On a vu récemment le gouvernement français bricoler des rognures, l’expression n’est pas trop forte, pour récolter quelques centaines de millions, alors que les 500 niches fiscales en France représentent au moins 145 milliards E, soit plus de la moitié des recettes nettes de l’Etat (rapport de la Cour des Comptes). Rien que l’exploitation de ces gisements fiscaux aurait pu permettre une autre médecine qu’une austérité qui risque d’étouffer toute possibilité de reprise. Nombre d’économistes nous répètent à longueur de pages et d’antenne que la vraie raison de la crise réside dans la stagnation des salaires due à un détournement du surplus économique (voir plus haut) et que la vraie solution au manque de revenus n’est pas dans la substitution du crédit aux salaires. Le « bon peuple » commence intuitivement à le comprendre, qui manifeste et se met en grève pratiquement toutes les semaines contre TINA, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Belgique et même en Grande-Bretagne (une première en cent ans, shocking, n’est-il pas ?)
* On se souvient en France du fameux « discours de Toulon », qui avait permis à Sarkozy en 2008 de gagner vingt points dans les sondages. Il promettait rien moins que de refonder le capitalisme : « La dictature des marchés, c’est fini ! La finance sauvage, c’est fini ! Les paradis fiscaux, c’est fini ! ». Trois ans après, rien n’a changé, sinon en pire. Les paradis fiscaux se sont tous extraits de la liste « noire » ou « grise » par un tour de passe-passe (coopérer pour la transparence… entre eux). Aux USA, malgré les espoirs suscités par Obama, le « lobby Goldman Sachs », en plaçant ses hommes (tels que Larry Summers ou Tim Geithner ; voir e.g. [Q]) au plus haut niveau du Trésor américain, a permis à Wall Street de l’emporter sur « Main Street ». A l’échelle mondiale, le système bancaire menaçant de s’écrouler, les Etats se sont portés à son secours et sont tombés à sa suite ; les banques sont sorties du trou, pas les Etats. Au Parlement européen, les lobbies ont tué dans l’œuf toutes les tentatives de réglementation des agences de notation. Enfin, cet automne, on peut dire que les « marchés » ont fait la preuve de leur puissance politique en forçant à la démission le Premier ministre grec et le Président du Conseil italien (ce que n’avaient pu faire des dizaines de manifestations et des centaines de milliers de manifestants). Quel était le crime du premier (Papandréou) ? Il avait voulu consulter le peuple sur une question qui engageait l’avenir de son pays. Révulsion de tout le gratin du G20 devant la seule évocation de la vox populi. Certes le référendum annoncé était mal pensé, mal préparé, mal venu (démocratie directe rime souvent avec démagogie, surtout en période trouble), mais il venait opportunément rappeler que la construction européenne s’était faite jusque-là plutôt dans la technocratie que dans la démocratie – témoin le traité de Lisbonne (voir encadré), qui contourna purement et simplement le non au référendum constitutionnel de 2005. On ne regrettera pas le départ du second (Berlusconi), mais qui est son remplaçant ? Mario Monti, un technocrate et un ex de Goldman Sachs. Et l’autre Mario, le nouveau président de la BCE ? Mario Draghi, un technocrate et un ex de Goldman Sachs. Quand les politiques se mettent à la remorque des « marchés », il y a danger pour la démocratie. Peut-être que financiers et politiciens doivent être tous mis dans le même sac. Peut-être qu’ils ont raison, les « Indignés », ces mouvements inorganisés de citoyens qui occupent les places les plus symboliques des cités pour réclamer, eux, les 99% du peuple (We are the 99), la « démocratie réelle ».
On a dit plus haut ne pas souhaiter que cette crise se dénoue dans le malheur des peuples. Mais si à quelque chose malheur devait être bon, ce serait paradoxalement le libéralisme lui-même qui nous montrerait comment se suicider par ses propres excès.
NGUYEN QUANG
.
Bibliographie :
[J] Paul Jorion : Le
capitalisme à l’agonie, Fayard, 2011
[L] Michael Lewis : Le casse du
siècle (The Big Short), éd. Sonatine, 2010
[P] Thierry Pech : Le temps des
riches -- Anatomie d’une sécession, Seuil, 2011
[Q] Jean-Michel Quatrepoint : La dernière bulle, éd. Mille et une Nuits, 2009
1 Voir « De 1929 à 2008 »
2 La « pyramide » ou « chaîne de Ponzi », du nom de son « inventeur », Charles Ponzi, qui spéculait vers 1920 à New York sur les timbres-poste internationaux, est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les capitaux des premiers clients en siphonnant ceux des derniers, jusqu’à ce que la machine coince faute de flux entrants suffisants. Le système est si primitif que même les collégiens le connaissent, sous le nom « d’avion » ou « parachute ». Il a pourtant permis à Bernard Madoff, un financier de New-York, d’escroquer ses investisseurs de plus de 60 milliards $. Depuis que le scandale a éclaté à l’automne 2008, les personnages inspirés de Ponzi-Madoff font le bonheur des séries télévisées américaines (Damages, saison 3 ; Boardwalk Empire, saison 1…)
3 Mais pas aux mathématiciens, à qui l’on rappelle que le logarithme de 2 est égal à 0,7 approximativement.
4 John Milton (1608-1674) est l’auteur du célèbre poème épique Paradise Lost (1667).
5 Certains marxistes ne seront peut-être pas d’accord.
6 Les « mathématiques financières », version moderne et sophistiquée du « calcul actuariel » dont se servent les compagnies d’assurance pour évaluer les risques, utilisent les outils les plus avancés de la théorie des probabilités (processus stochastiques, processus de Lévy…), mais leur pertinence, c-à-d. leur applicabilité à la réalité financière, est douteuse. Témoin la crise des subprimes, où les modèles mathématiques n’ont rien vu venir. Notre avis personnel est que ces grigris - pour rester courtois - servent simplement d’alibis à la spéculation financière.
7 Tous deux nobélisés. Mais il convient de noter qu’un nombre non négligeable de prix Nobel d’économie ont créé ou cautionné des fonds d’investissement qui ont fait faillite par la suite. Ceci relativise cela.
8 La fille d’un ami, fraîchement entrée à HEC, a découvert avec étonnement des « ateliers de discussion » où des groupes d’élèves s’entraînent tout à fait officiellement à « tuer (oralement) l’adversaire ». Dans le même ordre d’idées, un journaliste financier londonien, interrogé sur les dangers de la crise, s’est fendu de la fable suivante : « Un groupe d’amis se promène dans la forêt. Il est attaqué par un ours féroce et affamé. Tout le monde s’enfuit en courant, mais le plantigrade est bien plus rapide que les bipèdes. Conclusion : l’important n’est pas de courir plus vite que l’ours, c’est de courir plus vite que ses amis ».
9 Aux miséreux qui réclamaient du pain, la reine Marie-Antoinette aurait répliqué : « Qu’ils mangent des brioches ! » Dans une des ses nouvelles, Gogol raconte que des moujiks se sont révoltés quand ils ont appris que leur boyard s’était offert un pot de chambre en or. On peut aussi rappeler que Marie-Antoinette a trouvé une émule en Christine Lagarde, l’ancienne ministre française de l’Economie et des Finances, qui conseilla aux automobilistes, dont la hausse des prix des carburants grevait le budget, d’aller à leur travail à bicyclette.
Các thao tác trên Tài liệu