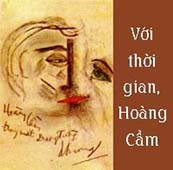Elections présidentielles américaines : N° 44 bis
Elections présidentielles
américaines
NUMERO 44 BIS
Nguyễn Quang
"Four more years". Après un an et demi de campagne acharnée, le verdict des urnes américaines a suscité dans le monde entier un soulagement perceptible, à la mesure de la crainte de voir ressusciter le spectre des années Bush. Et pourtant l'opposition républicaine était médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire : tel candidat ignorait ce qui se passait en Libye, tel autre oubliait l'intitulé du ministère qu'il voulait fermer; un "libertarien" réclamait la suppression du Trésor, de la Banque centrale et de l'Education Nationale tout à la fois; un représentant de la droite chrétienne, en dépit de positions grotesques sur les questions de société, faisait la course en bonne place jusqu'à le manque de finances lui coupe les jambes ; et le candidat finalement désigné, Mitt Romney, a reçu tellement de coups pendant ces primaires et négocié tellement de virages idéologiques que Bill Clinton le surnommait "le contorsionniste du Cirque du Soleil".
Et pourtant, c'est ce même "romnésique" qui soufflait dans le cou du président sortant dans la dernière ligne droite. Certes la victoire d'Obama ne souffre pas de contestation, aussi bien dans le vote populaire (environ 51%) que dans le collège des Grands Electeurs (plus de 330, alors qu'il en fallait 270), mais elle paraît étriquée au regard des espérances soulevées en 2008.
Poésie et prose
En 2008, le vent de l'Histoire soufflait sur la Maison Blanche, où entrait triomphalement un président jeune, charismatique, "post racial", qui semblait à la fois vouloir et pouvoir changer le monde. On se rappelle son discours de nomination à l'issue des primaires de 2008 : " Nous pourrons nous souvenir de ce jour et dire à nos enfants qu'alors nous avons commencé à fournir des soins aux malades et de bons emplois aux chômeurs; qu'alors la montée des océans a commencé à décroître et la planète à guérir; qu'alors nous avons mis fin à une guerre, assuré la sécurité de notre nation et restauré notre image de dernier espoir sur Terre." Même s'il est admis que les politiciens "mènent campagne en poésie et gouvernent en prose", rien n'empêche de faire un bilan et confronter la poésie du candidat à la prose du président Obama.
Chose rare pour un dirigeant américain, le nouvel élu, on s'en souvient, avait choisi d'inaugurer son mandat sur la scène internationale, en prononçant au Caire un discours fondateur sur les nouvelles relations qu'il souhaitait avec le monde musulman. Un prix Nobel de la Paix dans la foulée, et puis... Et puis pas grand chose. Au Proche-Orient, le processus de paix en Palestine est resté bloqué par le gouvernement israélien, qui a même multiplié les provocations, comme d'annoncer la construction de nouveaux logements pour les colons dans la partie annexée de Jérusalem le jour même d'une visite du vice-président Joe Biden. Pendant tout le "printemps arabe", qui allait pourtant dans le sens du discours du Caire, Washington est resté en retrait, visiblement inquiet pour ses alliances traditionnelles avec les régimes dictatoriaux. Au Moyen-Orient, la "main tendue" par Obama à Téhéran n'a recueilli que des rebuffades, au point que se pose maintenant avec acuité l'opportunité d'une intervention militaire contre les sites d'enrichissement d'uranium iraniens, qui plus est, suivant un tempo dicté par Israël. Enfin, dans l'enlisement (quagmire) irako-afghan hérité de Bush Jr, si le retrait d'Irak s'est correctement déroulé, celui d'Afghanistan prend des allures de retraite. De sorte qu'en Orient, le seul succès d'Obama aura été l'élimination de Ben Laden, mais à un moment où Al Quaeda, tout en conservant une certaine capacité de nuisance, s'est retrouvée marginalisée par les révolutions arabes.
Comme il est bien connu que les Américains se préoccupent peu de politique extérieure, venons-en à la politique intérieure, où le bilan d'Obama se répartit en trois rubriques :
- le sauvetage de l'économie : le candidat Obama de 2008 avait acquiescé au plan Paulson (du nom du ministre des finances du gouvernement Bush) de 700 milliards $ conçu pour éviter l'effondrement des marchés financiers, auquel le président Obama de 2009 adjoignit un plan de soutien de 2000 milliards pour faciliter le crédit et décharger les banques de leurs actifs "toxiques", puis un plan de relance de l'économie de 787 milliards, dont un tiers affecté aux allègements fiscaux en vue de favoriser la consommation, puis encore un fonds de stabilisation de 75 milliards pour enrayer les saisies immobilières et réaménager les emprunts des ménages en difficulté, et enfin un programme public-privé Geithner (du nom de son ministre des finances) de 500 à 1000 milliards destiné à purger le secteur bancaire des actifs à risque. A ces sommes colossales, il convient d'ajouter le plan de sauvetage de l'industrie automobile, avec des mesures fiscales en faveur des voitures "propres" et une aide financière pour restructurer Chrysler et General Motors. Fin Mai 2009, Chrysler se place sous la protection de la loi sur les faillites. Quand General Motors à son tour dépose son bilan, l'Etat lui injecte 30 milliards $, ce qui revient à une nationalisation à 61%, une première au pays de l’Oncle Sam. Il est reconnu que toutes ces mesures d'urgence ont sauvé l'économie américaine de la dépression, mais pas de la récession : fin 2009, le taux de chômage atteint un pic de 9,8%, son plus haut niveau depuis 1983 (10,1%) ; en août 2011, la dette des E-U s'établit à 100% du PIB, et l'agence Standard & Poor's abaisse la note de la dette souveraine américaine de AAA à AA+ . Mais pour Obama, le coût politique est encore plus élevé : les orthodoxes libéraux retrouvent de la voix ("Laissez Detroit faire faillite", réclame Mitt Romney), mais surtout "Main Street" se révolte contre Wall Street, engendrant dès avril 2009 le mouvement du "Tea Party" (voir ci-après).
- la réforme du système bancaire : alors que ce sont les activités spéculatives des banques qui ont déclenché la crise, c'est à leur secours que l'Etat vole en premier ("trop grosses pour faire faillite"), leur permettant de se refaire une santé dès le début de 2010 et de renouer avec les profits, primes et bonus comme si de rien n'était. De fait, l'administration Obama a raté une "fenêtre de tir" pendant laquelle elle aurait pu profiter de la déconfiture du secteur bancaire et financier pour engager une véritable régulation. Une mesure emblématique eût été de rétablir le Glass-Steagall Act de 1933 (abrogé par Bill Clinton en 1999) qui imposait la séparation des activités de dépôt (banques commerciales) d'avec les activités d'investissement (banques d'affaires). Au lieu de s'appuyer sur des principes simples de responsabilité et de transparence, le Congrès démocrate fabrique en juillet 2010 une usine à gaz, la loi Dodd-Frank, un texte de 848 pages que sa complexité semble condamner à ne pas être appliqué. De fait, Obama lui-même avouera s'être désintéressé de cette réforme pourtant nécessaire, trop content de s'en décharger sur les technocrates de son cabinet -- tous formatés Goldman-Sachs, de Tim Geithner à Larry Summers -- afin de se consacrer à ce qu'il considérait comme son grand oeuvre, "l'Obama care".
- la réforme du système de santé : pour comprendre l'importance du projet d'Obama care, il faut se rappeler que le système de santé américain est actuellement le plus onéreux, et en même temps l'un des plus inefficaces du monde. Alors que le pays y consacre 15% de son PIB (deux fois plus qu'en France), il se place en queue de peloton des nations riches pour la couverture maladie. Parce que seuls les plus de 65 ans et les plus pauvres peuvent bénéficier de programmes publics (Medicare pour les premiers, Medicaid pour les seconds), parce que les cotisations d'assurances ont explosé (+78% entre 2001 et 2008), de même que les les rémunérations des professionnels de santé (un médecin généraliste américain gagne 4,1 fois le revenu moyen, un spécialiste 6,5 fois, contre 2,8 et 3,9 en moyenne dans les pays de l'OCDE, l'écart de ces rémunérations représentant à lui seul 2% du PIB), la Kaiser Family Foundation recensait en 2010 cinquante millions d'Américains dépourvus de toute couverture, soit un habitant sur six. On se souvient des reportages montrant les files de patients faisant la queue pour se faire soigner par des médecins itinérants bénévoles - spectacle digne d'un pays du tiers-monde, pas du pays le plus riche de l'histoire de l'humanité. Ne serait-ce que du point de vue productif, la mauvaise santé d'une population a son coût, et il était donc impératif de réformer un système qui servait en premier lieu à engraisser médecins et compagnies d'assurances. Hillary Clinton s'y était colletée sans succès en 1994. Barack Obama s'y est attelé pratiquement depuis 2009 jusqu'à la fin de son premier mandat. Votée en 2010, la loi a subi attaques et manoeuvres dilatoires de toutes sortes - législatives, judiciaires - jusqu'à quatre mois des élections de 2012, quand la Cour Suprême l'a déclarée conforme à la Constitution, par 5 voix contre 4. La principale disposition de l'Obama care étend une sorte de couverture santé "universelle", obligatoire sous peine de pénalités, à 32 M d'Américains qui en étaient dépourvus (les guillemets viennent de ce que sont laissés pour compte 5% des résidents américains, non citoyens). Les entreprises de plus de 50 salariés (PME et commerçants) qui ne fourniront pas de couverture seront également pénalisées. Des subventions fédérales seront prévues pour aider les familles aux plus bas revenus. Il sera interdit aux assurances de refuser de couvrir des personnes en invoquant leurs antécédents médicaux. Le comble de l’ironie, c’est que ce plan santé s’inspire du MassHealth instauré au Massachusetts… par Mitt Romney quand il était gouverneur de cet Etat. Mais le lobby des assureurs n'aura pas tout perdu, puisque la loi n'instaure pas de régime public universel, ni même d'assurance publique, contrairement au souhait initial du réformateur. Cette protection minimale fera sourire plus d'un Européen habitué à l'Etat-providence, elle n'en constitue pas moins la plus belle victoire d'Obama au plan intérieur. Et la seule, car après la victoire républicaine aux élections de mid term en 2010, le président s'est retrouvé paralysé par une opposition qui n'entendait lui faire aucune concession.
Une nation déboussolée
En 2008 pourtant, quand le Grand Old Party avait perdu à la fois la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des Représentants, aucun observateur ne donnait cher de son avenir à moyen terme. Le schéma de pensée majoritaire était que, comme la Grande Dépression de 1929 avant elle, la Grande Récession de 2008 allait inaugurer une "période longue" de prééminence démocrate, à la fois dans les urnes et dans la doxa américaine (1). Or deux ans plus tard, non seulement les républicains reprenaient la chambre basse, mais ils le faisaient sans le moindre compromis idéologique, sans renier aucun des principes néo-libéraux qui avaient mené le pays - et le monde - au bord du gouffre. On peut certes y voir la responsabilité d'un Obama se trompant de priorité, plus occupé à réformer le système de santé qu'à réguler la finance ou résorber le chômage. Mais les vraies raisons nous semblent beaucoup plus profondes, elles sont d'ordre identitaire.
Concrètement, ce qui a permis aux conservateurs d'enrayer le mécanisme de la "période longue" promise aux démocrates, c'est un événement conjoncturel qu'ils ont su saisir au bond : la manifestation nationale de "Main Street" contre Wall Street en février 2009 (un mois après l'investiture d'Obama), contre tout à la fois l'impunité des banquiers et le plan de relance économique qui leur fait la part belle. A noter qu'il ne faut pas confondre cette révolte avec le mouvement anti-capitaliste "Occupy Wall Street" de septembre 2011, qui s'inscrit, lui, dans la mouvance planétaire des "Indignés". Main Street, comme le sait tout amateur de cinéma américain, c'est un condensé de l'American way of life, c'est la rue principale de toute ville américaine, petite ou moyenne, où se concentrent l'activité et les échanges de la communauté. "Main Street, c'est le monde des PME et des gens qui travaillent pour produire et échanger des biens et des services -- un monde où la richesse est concrète. Wall Street, telle qu'elle existe maintenant,est un monde d'argent pur, dans lequel l'unique but est d'utiliser l'argent pour en faire gagner encore plus à des gens qui en ont déjà -- un monde de gains spéculatifs et de prétention imméritée à l'encontre de la richesse concrète de Main Street" (2). Le cinéphile sait aussi que la richesse humaine de Main Street, c'est la sagesse de ses natifs, avec leur bon sens un peu naïf mais qui pourrait en remontrer aux roueries des politiciens les plus chevronnés de la capitale. On rencontre ces archétypes vivants dans les merveilleux films de Frank Capra, de Mr Deeds goes to town, avec Gary Cooper (1936) à Mr Smith goes to Washington, avec James Stewart (1939). C'est en 2009, le 15 avril (dernier délai pour la déclaration d'impôts) que naît officiellement le Tea Party, qui officiellement n'est pas un parti, mais un mouvement populiste surfant sur les thèmes de Main Street : anti-élites, anti-impôts, anti-Etat... TEA est l'acronyme de "Taxed Enough Already", mais il renvoie aussi à un épisode fondateur de l'indépendance américaine, quand des colons révoltés avaient jeté à la mer des ballots de thé pour protester contre un nouvel impôt levé par la Couronne britannique. De fait, le mouvement se révèle vite comme proche de l'aile ultra-droite républicaine (avec une figure emblématique comme Sarah Palin), dressée contre trois ennemis principaux : l'Etat fédéral (toujours); le "socialiste" ou "fasciste" (c'est tout comme) Obama et son plan de santé; les "politiciens" de Washington, y compris les "rhinos" (Republican in name only), sur lesquels il convient de tirer à vue. Sous-estimé au départ par les partis officiels, le TEA devient incontournable après le succès de sa "grande marche des contribuables" sur Washington le 12 septembre 2009. Structuré par des pros de l'action politique (comme l'organisation Freedom Works), financé par certaines grandes fortunes de droite (comme le milliardaire Richard Scaife ou les frères Koch), soutenu par des chrétiens fondamentalistes (via des fondations comme l'American Family Association), il peut bientôt se targuer de l'appui de 25 à 30% des Américains, et il le prouve en remportant aux élections de mi-mandat 3 sièges de sénateurs et 60 de députés (c'est-à-dire les 3/4 des gains républicains!) Rien d'étonnant, donc, si les primaires républicaines, puis la campagne de Mitt Romney, pourtant étiqueté à l'origine comme un républicain modéré, se soient situées à droite toute.
Or que représente la droite républicaine, et en particulier le Tea Party ?
S'agissant du GOP proprement dit, depuis des années, les zones électorales en bleu (à majorité démocrate) et rouge (à majorité républicaine) montrent une dichotomie frappante entre deux Amérique : très grossièrement, une Amérique bleue, celle des côtes Ouest et Nord-Est, urbaine, peuplée, cosmopolite; rouge, l’Amérique du Sud et de l'intérieur, rurale, peu peuplée mais homogène. Les sondages de sortie des urnes confirment cette bi-polarisation : les grandes villes ont voté démocrate à 69%, les petites républicain à 56%. Sociologiquement, en schématisant, ce sont les jeunes, les femmes, les urbains, les pauvres, les sans religion et les minorités (les Noirs bien sûr, à 93%, mais aussi les Latinos, à 71%) qui ont réélu le président sortant. Comme 59% des Blancs ont de leur côté voté pour Romney – une progression de 4 points par rapport au score de John McCain en 2008 - on peut en conclure que, loin du mythe espéré par Obama d’une Amérique post-raciale, toute une partie de l’Amérique blanche ne se reconnaît toujours pas dans le premier président métis de son histoire - même si elle doit reconnaître, selon les mots d’un journaliste de Fox News, que « l’Amérique traditionnelle n’est plus [et que] l’establishment blanc est maintenant en minorité. »
S’agissant de l’ultra-droite et du Tea Party, la composition sociologique de leurs militants et sympathisants est encore plus connotée : majoritairement blancs (à 89%), relativement âgés (plus de 45 ans pour les ¾), plus diplômés que la moyenne, plus financièrement à l’aise aussi (revenus supérieurs à 50 000$ par an), ce sont moins des victimes de la crise que des représentants des classes moyennes ou moyennes supérieures blanches. La crainte qui les fédère, c’est de se voir basculer dans le camp des perdants : 92% pensent que leur pays est sur la mauvaise voie – bien plus que la moyenne nationale, qui s’établit à 65%. La peur de l’avenir et un pessimisme prononcé, voilà qui est nouveau au pays du « rêve américain ». Le thème du déclin est omniprésent dans la littérature politique récente aux E-U, d’Arianna Huffington (Third World America, 2010) à Morris Berman (Why America failed : The roots of imperial decline, 2011). Sans entrer dans des considérations sociologiques toujours discutables (par définition de la sociologie), au moins une explication objective de la vulnérabilité nouvelle des classes moyennes tient à la désindustrialisation visible de l’Amérique – le même constat s’applique d’ailleurs à l’Europe. Mondialisation, délocalisations, importations massives de produits manufacturés bon marché des pays émergents, tout concourt à la disparition progressive du made in America. Sauf dans des domaines de pointe comme l’informatique, l’aéronautique et la production d’armements, la tendance générale est à la conversion d’une société industrielle vers une société de services, ce que les spécialistes appellent la « wal-martisation » de l’économie. D’où vient ce néologisme ? De Wal-Mart bien sûr, le géant américain de la grande distribution. Ce qu’on sait moins, c’est qu’avec un chiffre d’affaires de 446 milliards $ en 2011, Wal-Mart domine le capitalisme mondial. Devant Exxon allié à Mobil. Loin devant le pétrolier Chevron, deux fois plus petit. Encore plus loin devant Apple (108 milliards), très loin devant Microsoft (70 milliards), Coca-Cola (46 milliards) ou Nike (20 milliards)… L’historien de l’économie Nelson Lichtensein note que « à chaque grande époque, une firme qui incarne un nouveau type de structures économiques et sociales émerge. A la fin du 19ème siècle, la compagnie de chemin de fer Pennsylvania Railroad s’est auto-proclamée « référence universelle ». Au milieu du 20ème siècle, General Motors a symbolisé l’ère de la production de masse, autour d’un management centralisé et d’une maîtrise technologique. Dans les années 1990, c’est Microsoft qui a paru incarner un nouveau monde, celui de l’ère post-industrielle, de l’économie du savoir. Pourtant, le vrai modèle du nouveau siècle est ailleurs : c’est Wal-Mart, avec son système mondial de production , de distribution et, même, d’emploi » (3). Or quel est le credo de Wal-Mart ? Des prix bas, donc des salaires bas, pas d’avantages sociaux et un turn over élevé pour éviter, justement, l’octroi de tels avantages. Henry Ford payait bien ses ouvriers pour qu’ils puissent acheter des voitures. Avec Wal-Mart, l’Amérique passe au low cost, qui ne produit plus de classes moyennes, mais des working poor.
C’est dans ce contexte dépressif que le 44ème président des E-U « en reprend » pour quatre ans. « Four years more », cela sonne bien plus platement que le vibrant « Yes, We Can » de 2008. Mais on ne demande qu’à croire le numéro 44 bis quand il nous promet que « le meilleur reste à venir ». Forcément. ¤
NGUYỄN QUANG
(1) Voir Numéro 44, Dien Dan, Nov. 2008
(2) D. Korten, Main Street before Wall Street, dans Yes !, 24 septembre 2008
(3) Cité dans L. J. Baudu & G. Biassette, Travailler plus pour gagner moins : La menace Wal-Mart, Buchet-Chastel, 2008.
Các thao tác trên Tài liệu