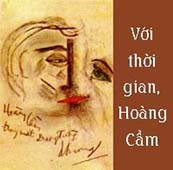En attendant Obama : NUMERO 44
En attendant Obama
Numéro 44
Nguyễn Quang
voir la version vietnamienne : ici
Le système politique américain est d'une telle stabilité que les gens ont l'habitude de désigner les présidents par leur numéro d'ordre, un jeu couru étant d'en citer la liste complète en mettant des noms. Ainsi George Washington, bien sûr, est le premier, Abraham Lincoln le 16ième, John F. Kennedy le 35ième... Mais dans cette nomenclature, le 44ième sera un peu plus spécial que les autres, et pour de multiples raisons, comme si l'Histoire avec un H avait elle-même conspiré pour mettre son avènement sous les auspices les moins ordinaires : le 44ième sera le premier président noir des E-U ; son prédécesseur en aura été le président le plus désastreux, qui en huit ans a engagé son pays dans deux guerres et détruit l'image de l'Amérique dans le monde ; et la relève se fera dans les pires conditions économiques et sociales depuis la Grande Dépression.
La « question de couleur »
Barack Obama, on l'aura remarqué, est noir ; en langage politiquement correct, un citoyen afro-américain ; en termes moins choisis, un «bronzé» (Berlusconi) ; dans une formulation un peu plus châtiée, «le premier candidat afro-américain qui parle bien, qui est intelligent, qui est propre sur lui et qui a une bonne gueule» (le vice-président élu, Joseph «La Gaffe» Biden). On mesure le chemin parcouru quand on pense qu'il y a moins d'un demi-siècle, dans certains Etats ségrégationnistes, les Noirs étaient privés du droit de vote. Certains politologues ou sociologues ergotent sur le fait qu'Obama est en réalité un métis, né d'une Blanche du Kansas et d'un Noir du Kenya (1), mais il est quand même symptomatique qu'on se réfère à ce métis comme un Noir de mère blanche, et non comme un Blanc de père noir. Pour ne pas oublier à quel point la question «de couleur» structure encore les rapports sociaux aux Etats-Unis, cent quarante ans après l'abolition de l'esclavage, il faut rappeler qu' «une seule goutte de sang noir» suffisait à vous faire classer comme Noir, que l'ensemble des lois ségrégationnistes n'a été aboli qu'en 1964 sous la présidence Johnson, et que la discrimination se traduit encore de nos jours par une inégalité sociale et politique criante. Inégalité sociale : dans le comté de Watts par exemple (foyer des émeutes urbaines de 1965), le revenu moyen est inférieur à la moitié de celui de l'agglomération de Los Angeles dans son ensemble, 37% des adultes de plus de 25 ans ne possèdent pas de diplôme «high school», le chômage est toujours au niveau de 1965 (23%), 60% des enfants vivent en dessous du niveau de pauvreté... et 1 jeune sur 9 est en prison ! Inégalité politique : depuis la «reconstruction» de 1877, en presque 150 ans, seuls deux Noirs sont parvenus à devenir gouverneurs, et trois (Obama compris) sénateurs. Alors, un président métis élu à 53% et soutenu, en plein état de grâce, par près de 80% d'une population où les Noirs ne sont que 12%, oui, c'est un événement historique.
Mais cet événement est-il une rupture ou un aboutissement ? Malgré l'extinction des mouvements pour les droits civiques à la fin des années 60, on s'aperçoit maintenant que les forces mises en branle n'ont pas arrêté leur travail souterrain pour refaçonner la perception du problème «de couleur» par la société américaine. Certes on est encore loin du rêve de Martin Luther King, mais par touches imperceptibles mais au total décisives, la psychologie collective a changé. Symptôme parmi d'autres, la notoriété d'une personnalité noire, du sport (Tiger Woods) ou du spectacle (Will Smith), est maintenant considérée comme une réussite professionnelle normale, alors que naguère, une telle personnalité se sentait obligée se surjouer le rôle du «nègre blanc» (Sammy Davis Jr (2)) ou du «nègre rebelle» (Cassius Clay, alias Muhammed Ali). Encore un symptôme, la culture populaire, et surtout sa forme la plus puissante, le cinéma, pour des raisons politiquement correctes ou pas, peu importe, a fini par imposer la figure du héros noir, on veut dire par là un héros ordinaire qui se trouve être un Noir. C'est ainsi que, suivant une «private joke» de cinéphile, le premier président noir des E-U est... Morgan Freeman (3). Enfin, la réalité rejoignant la fiction, le «plafond de verre» du pouvoir s'est indéniablement fissuré, une fissure qu'on peut suivre en pointillé sur vingt ans, de Bush 1 à Bush 2 en passant par Clinton : un Noir, Colin Powell, chef-d'état-major inter-armes, c'est-à-dire au plus haut poste de l'appareil militaire américain ; deux Noirs successivement, Colin Powell puis Condoleezza Rice à la tête du Département d'Etat, c'est-à-dire au plus haut poste de l'exécutif après le président ; un Noir, Clarence Thomas, juge à la Cour Suprême, c'est-à-dire la plus haute institution judiciaire et constitutionnelle des E-U... On s'aperçoit rétrospectivement qu'il suffisait de prolonger la courbe, comme disent les mathématiciens, pour aboutir au «numéro 44».
Candidat noir, Obama était attendu sur la question «de couleur». Politicien inné, il a su sentir que l'air du temps lui permettait de se projeter au-delà, de se présenter comme un Noir mais pas comme le représentant des Noirs, d'éviter la rhétorique enflammée et revendicative des leaders noirs (Malcolm X, Jessie Jackson...), de profiter au contraire de son métissage et de son parcours pour appeler au changement en dépassant les clivages politiques, sociaux et raciaux. Simple habileté tactique ? Le vote noir (traditionnellement démocrate à 90%) lui étant acquis, l'intérêt bien compris d'Obama était de ne pas effaroucher l'électorat blanc. Mais à un moment crucial des primaires, il s'est quand même retrouvé le dos au mur quand la chaîne ABC News a révélé ses liens étroits avec un pasteur noir, le révérend Jeremiah Wright, dont les sermons anti-blancs n'ont rien à envier aux invectives de Malcolm X : «Que Dieu maudisse l'Amérique pour avoir traité certains de ses citoyens comme des sous-hommes ! Que Dieu maudisse l'Amérique aussi longtemps qu'elle se prend pour Dieu et qu'elle se croit la nation suprême !» La réaction du candidat à cette crise majeure de sa campagne donne à la fois la mesure de son talent et de ses convictions. Au lieu d'esquiver, de nier ou de chercher l'apaisement à tout prix, Obama prend la question de front et fait du racisme le thème central de son discours de Philadelphie (18 mars 2008), un discours fondateur que d'aucuns comparent au prêche de Martin Luther King sur le Mall de Washington («J'ai fait un rêve...»), ou même à l'adresse de Lincoln à Gettysburg («le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple...») Evoquant le révérend Wright, mais aussi sa grand-mère qui l'a élevé en dépit de ses préjugés racistes de femme blanche, Obama assume son identité tout en affirmant sa foi dans l'Amérique : «Ces personnes font partie de moi. Et elles font partie de l'Amérique, ce pays que j'aime [...] J'ai affirmé ma conviction profonde -- une conviction ancrée dans ma foi en Dieu et ma foi dans le peuple américain -- qu'en travaillant ensemble nous parviendrons à panser nos vieilles blessures raciales, et que nous n'avons plus le choix en réalité si nous voulons continuer d'avancer dans la voie d'une union plus parfaite.» Une «union plus parfaite», c'est en l'occurrence l'idéal des Pères Fondateurs : «Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux». Même s'il a été élu contre une majorité blanche (43% contre 55%), le numéro 44 semble s'être déjà projeté dans une Amérique post-raciale quand, dans son discours d'investiture sur les marches du Capitole, il n'a consacré au problème «de couleur» qu'une seule phrase, mais ô combien symbolique : «Un homme dont le père n'aurait pas pu être servi dans un restaurant du coin peut aujourd'hui prêter le serment le plus sacré.»
Manquements éthiques
« Notre pays doit faire un choix, un choix qui ne porte pas purement et simplement entre deux hommes ou deux partis, mais entre l'intérêt général et le confort privé, entre un engagement déterminé et une médiocrité rampante.» Barack Obama ? Non, J.F. Kennedy présentant son programme de Nouvelle Frontière. Cette phrase date de 1960 mais elle pourrait parfaitement s'appliquer à la situation actuelle, à une Amérique en plein marasme économique et moral après huit années de bushisme. Il est admis que «W» a connu ses deux échecs les plus graves sur le front de la guerre contre le terrorisme, quand sa croisade contre «l'axe du Mal» s'est enlisée dans le bourbier irakien, et sur le front économique, quand son projet néo-libéral s'est fracassé contre le mur de la crise financière. Mais son impopularité record (moins de 18% d'opinions positives) tient aussi à des raisons éthiques -- un point de vue proprement américain, incompréhensible pour les citoyens cyniques ou «démocratiquement avachis» du Vieux Continent (4).
Président mal élu en 2000, mais qui a pris subitement une tout autre stature après les attentats du 11 Septembre, à un moment où une grande nation attaquée sur son sol (pour la première fois de son histoire) ne demandait qu'à s'en remettre au commander in chief, George W. Bush aurait pu entrer dans le panthéon des grands leaders américains. Au lieu de quoi, il a cru disposer d'un blanc-seing pour mener une politique ultra-partisane qui a divisé un pays en besoin d'unité. Nous reviendrons plus loin sur les objectifs de cette politique, mais disons tout de suite que ce sont ses moyens que les Américains ont fini par juger contraires à l'éthique : une «com» parfaitement maîtrisée (notamment par le stratège républicain en chef, Karl Rove), mais fondée sur la falsification et la dissimulation, s'est heurtée in fine à l'entêtement des faits, démontrant encore une fois «qu'on peut mentir à certains pendant un certain temps, mais pas à tous tout le temps»(4). Ainsi de l'Irak, où la formidable manipulation de l'opinion sur les «armes de destruction massive», la censure médiatique sur les pertes humaines, la dissimulation des violations répétées des droits de l'homme (Abu Ghraib) et de l'Etat de droit (Guantanamo) n'ont pu empêcher qu'éclatent au grand jour les dégâts d'une guerre absurde (aucune ADM sous le sable), sanglante (4.000 militaires américains tués, 40.000 blessés, 12.000 mutilés), coûteuse (un trillion, c-à-d 1.000 milliards de dollars, l'équivalent du plan de relance économique d'Obama). Ainsi de l'ouragan Katrina, en Septembre 2005, qui a brutalement révélé l'écart béant entre la rhétorique du «conservatisme compassionnel» (slogan de la campagne 2004) et la réalité d'une Amérique racialement et socialement divisée, où les défavorisés sont abandonnés à eux-mêmes, dans l'indifférence ou le mépris des nantis ; entre la compétence auto-proclamée des dirigeants et l'incompétence flagrante de leurs troupes dans l'organisation des secours ; entre l'hostilité des idéologues à toute intervention de l'Etat et leur incapacité à pallier l'absence dudit Etat. Ainsi du projet d'une «société de propriétaires» (autre slogan de 2004) -- on sait ce qu'ont donné les «subprimes»... Ce qui caractérise au fond l'armature intellectuelle du bushisme, c'est le mépris, au profit de l'idéologie, du principe de réalité. On se souvient de la profession de foi d'un néo-con à l'adresse du journaliste Ron Suskind en 2002 : eux, les bushistes, n'avaient rien à faire avec les gens de la 'reality-based community', les gens qui «croient que des solutions peuvent naître d'une étude judicieuse de la réalité discernable [...] Nous créons notre propre réalité.» On a vu la nature de cette 'réalité' à propos des ADM en Irak. Mais une telle attitude conduit aussi tout droit au rejet ou à la falsification de la connaissance scientifique quand elle contredit l'idéologie, et c'était en fait une des armes préférées des bushistes. Leur «stratégie de la confusion» consistait à mettre sur le même plan, d'un côté la recherche scientifique proprement dite, avec ses inévitables incertitudes, de l'autre toutes sortes d'évaluations présentées sans protocoles de vérification, produites par des organes liés aux lobbies industriels ou religieux. Le débat sur l'effet de serre et le réchauffement climatique est bien connu, mais on pourrait citer aussi les cellules-souches, la contraception, la neuro-toxicité du plomb... sans oublier l'offensive des créationnistes contre la théorie darwinienne. Cette malhonnêteté intellectuelle a bien sûr été dénoncée, et en termes de plus en plus vifs, par la communauté scientifique, comme dans ce rapport publié en 2004 et qui accuse les autorités américaines d'avoir «ébranlé les procédures ayant traditionnellement assuré une utilisation objective, non partisane, des résultats scientifiques dans la formulation des politiques publiques». Mais le mal est fait. Des doutes jetés sur les données scientifiques à la remise en cause de la démarche scientifique, il n'y a qu'un pas, qui peut vite être franchi : des politiques qui ne croient plus qu'aux lobbies, un public qui ne croit plus à la science mais aux fausses sciences, des vocations qui se détournent des études scientifiques... Les dégâts à long terme peuvent se révéler incalculables, ne serait-ce qu'à cause de l'apport prépondérant des sciences et techniques à la puissance américaine. C'est pourquoi l'appel d'Obama au «retour de la science à la place qui lui convient» n'a rien d'anodin.
Alternance à l'américaine
Avant même l'issue des primaires, le soussigné avait
parié un dîner collectif que n'importe quel
candidat démocrate l'emporterait en 2008 sur n'importe
quel candidat républicain (une trace édulcorée
de ce pari peut se trouver dans (5)). Gagné ! Bien
sûr, l'éclatement de la crise financière et
économique y a beaucoup aidé, mais notre présomption
se basait en fait sur l'examen du fonctionnement séculaire du
bipartisme américain, dont l'histoire est rythmée par
des périodes de «domination longue» de l'un ou
l'autre des deux grands partis (avec occasionnellement des intermèdes
non significatifs). Mais ce mouvement de bascule ne saurait se
réduire à une simple alternance comme on en connaît
dans les démocraties européennes. D'abord, les
deux grands partis américains ne se placent pas de façon
constante sur un axe gauche-droite: même si depuis un
siècle, les républicains sont plutôt
classés «conservateurs» et
les démocrates «libéraux»
(au sens américain, c-à-d de tendance
sociale-démocrate), il n'en a pas toujours été
ainsi, un facteur historique essentiel résidant dans la
question «de couleur» et la
division politico-économique
Nord-Sud. Il ne faut pas oublier que le parti
actuel de
Bush, le Grand Old Party,
était celui de Lincoln et des
abolitionnistes, à l'époque où les démocrates
représentaient plutôt les petits Blancs hostiles à
l'émancipation des Noirs. Ensuite, les bascules gauche-droite
se produisent à l'occasion de certaines élections
cruciales où, par une évolution de sa thématique
et/ou un renouvellement de son électorat, par un «mouvement
tournant» (c'est aussi le sens du mot «révolution»), un
parti l'emporte durablement sur l'autre. Cette alternance à
l'américaine éclaire et résume, même
à grands traits, l'histoire politique des E-U. Le 20ième
siècle au sens large a connu trois telles «révolutions» :
l'élection de William Mc Kinley, qui marque la conversion du
GOP au big business ; le New
Deal de Franklin D. Roosevelt, qui
réussit à rassembler une coalition de «cols bleus»
et de «cols blancs» pour sortir de la Grande Dépression
et asseoir une prédominance démocrate qui culminera
dans les mouvements pour les droits civiques et la Great Society de
Lyndon B. Johnson ; la «révolution conservatrice» de
Ronald Reagan (préfigurée par le mandat et demi de
Richard Nixon), qui réussit à fédérer les
conservateurs de toutes tendances (contre l'Etat, contre le
communisme, pour la défense des valeurs traditionnelles), mais
surtout, à débaucher les «cols bleus» du Sud
opposés aux droits civiques, ceux qu'on appelle depuis
les «Reagan democrats». Parce qu'il est en phase avec
d'autres poussées conservatrices dans le monde (comme en
Grande-Bretagne avec Mme Thatcher) et une résurgence des
thèses économiques libérales, le reaganisme
va installer la domination du GOP pendant un quart de siècle.
Les années Clinton doivent être considérées
comme un intermède, libéral (au sens américain)
sur le plan social, libéral (au sens capitaliste) sur le plan
économique -- ne pas oublier qu'après Reagan,
l'administration Clinton poursuivra avec assiduité la
dérèglementation du commerce et de la finance. Quand
Bush 2 reprend le flambeau de Bush 1, c'est avec un esprit de revanche
et l'ambition, soufflée par Karl Rove, d'une
révolution «néo-conservatrice» qui balaierait
définitivement l'héritage du New Deal. Le contexte
des années 2000 semble favorable, avec la croissance apportée
par la Nouvelle Economie, l'adhésion commune aux lois du
marché, les rêves d'enrichissement pour tous,
l'individualisme forcené... Avec l'union sacrée née
du 11 Septembre, les néo-cons croient pouvoir saisir une
chance historique. Leur échec pose une question intéressante.
Les revers subis (Irak, Katrina...) sont-ils contingents, ou bien
sont-ils les symptômes ou les déclencheurs d'un
mouvement d'opinion profond, la première «révolution»
américaine (au sens expliqué plus haut) du 21ième
siècle ? Le credo conservateur a pour maître mot
la «responsabilité individuelle» (self-reliance), une
idée profondément liée dans la psyché
américaine aux idées de dynamisme et
d'opportunités, et que les idéologues républicains
ont magistralement orchestrée en l'accouplant
aux deux
vieilles rengaines du rejet de l'Etat («L'Etat n'est pas la
solution, c'est le problème») et de l'acceptation
des lois du marché (la «main
invisible»). Le succès
de la «révolution
conservatrice» peut se juger
à l'association, désormais ancrée dans la
mémoire collective, entre la présidence Reagan et la
nostalgie d'une époque brillante de la nation américaine. Mais
qui dit «nostalgie» dit que les temps ont changé, et
les sondages concernant la présidence Bush
(notamment dans les enquêtes à long terme du réputé
Pew Institute) réservent des surprises. Répartition
des opinions entre les deux grands partis ?
Républicains
et démocrates font jeu égal (43%) en 2002, au
lendemain des attaques terroristes, mais ensuite l'avance démocrate
ne cesse de croître, pour atteindre 50% contre 35% en 2007.
Opinions vis-à-vis du big business ? Elles sont constamment
négatives, de -14% en 2002 (après les scandales Enron
et World Com) à -20% en 2007 (avant les subprimes !)
Insécurité économique ? En 2006, 62% pensent
qu'elle est plus grande qu'il y a vingt ou trente ans.
Confiance en
l'avenir ? A la question de savoir si leur situation est meilleure ou
pire qu'il y a un an, 55% des personnes interrogées en 2007
(contre 26%) répondent «pire», et 78% jugent que
l'Amérique «est sur de mauvais rails». Un tel
pessimisme n'est pas sans fondement : avec une économie
en piètre état (6), le creusement des inégalités
et la destruction des amortisseurs sociaux, le problème
de la "répartition des fruits de la croissance" est
devenu un enjeu politique majeur, et les Américains se sont
aperçus que le «conservatisme compassionnel» n'a pas
empêché la classe moyenne de «se vider par les
deux extrémités» (6), un peu en direction des
working rich, beaucoup en direction des working poor.
La science politique n'étant pas une science exacte, le rejet de l'idéologie néo-con ne signifiait pas assurément l'imminence d'une «révolution» (au sens expliqué précédemment). Restait l'incertitude glorieuse de la campagne. C'est alors que Barack Obama est apparu comme un OVNI dans le paysage électoral. Qui aurait cru qu'un quasi-inconnu sans expérience politique significative parviendrait à terrasser successivement les caciques des deux grands partis ? Le numéro 44 a mené une campagne qui restera probablement dans les annales comme un modèle à la fois de professionnalisme et d'inventivité, véritablement la première campagne électorale du 21ième siècle. On retiendra seulement ici le formidable élan démocratique qu'il a insufflé à un système, il faut bien le dire, archaïque et sclérosé. Cyber-candidat, il a utilisé Internet d'une manière révolutionnaire pour mobiliser 8 millions de militants et créer en quelque sorte la première communauté politique sur la Toile. Candidat novice du fund raising, il a recueilli les contributions financières de 3 millions de supporteurs, souvent de quelques dizaines ou quelques centaines de dollars, mais qui mises bout à bout lui ont donné un trésor de guerre double de celui de ses adversaires. Candidat inspiré et charismatique, il a mobilisé les électeurs à un niveau historique, 66% des inscrits, 10% de nouveaux votants (dont 72% se sont prononcés pour lui). Candidat porteur de trop d'espoirs, il ne pourra que les décevoir. C'est pourquoi, à l'heure où il prend ses fonctions, on ne spéculera sur aucun de ses projets, on constatera simplement que, comme par magie, il a rendu à son pays -- qui a élu un Noir et aurait pu élire une femme -- sa place parmi les nations démocratiques : tout bonnement la première. «Si jamais quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, s'il en reste un qui se demande si le rêve de nos pères fondateurs est toujours vivant, s'il doute encore de la puissance de notre démocratie, la réponse lui est donnée ce soir.» (discours de victoire, à Chicago)
NGUYỄN QUANG
NOTES :
(1) Commentaire pointu d'une Vietnamienne de "Cali" : «Non seulement il est noir, mais il n'est même pas Américain!»
(2) Sammy Davis Jr, chanteur des années 60, dont le titre de gloire est d'avoir intégré le "clan Sinatra", lui, «noir, juif et borgne». Il s'en vante dans son autobiographie, "Yes, I can", dont Obama a détourné le titre.
(3) Dans le film-catastrophe Deep Impact (1998).
(4) Toute référence à la situation française est intentionnelle.
(5) Voir "Le Moment 68", Dien Dan, Mai 2008.
(6) Voir "De 1929 à 2008" (Diễn Đàn)
Các thao tác trên Tài liệu